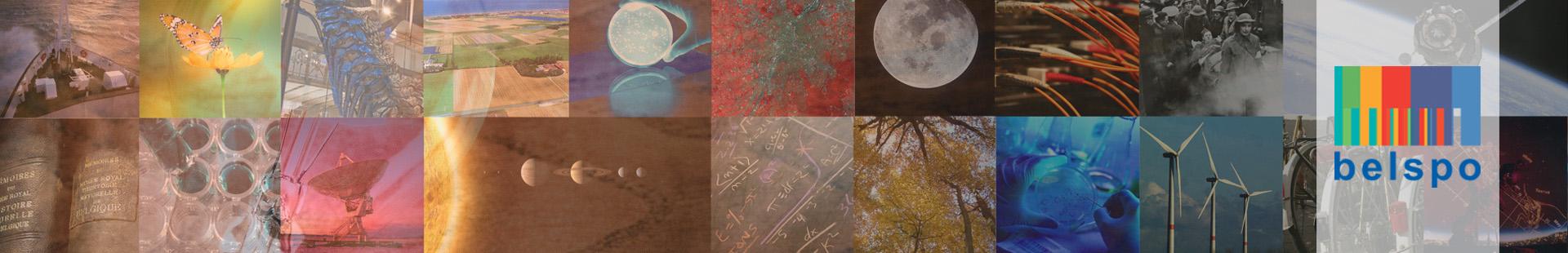
Projet de recherche AM/13/018 (Action de recherche AM)
Les services de réseau (télécommunications, électricité...) subissent actuellement de profonds bouleversements, certains étant induits par leur ouverture progressive à la concurrence. Ce changement de contexte a sans nul doute des répercussions sur l’organisation du secteur : différents prestataires, privés ou publics, sont à présent amenés a répondre aux besoins prioritaires des usagers et, en particulier, prester - ensemble ou séparément - un « service universel » déterminé par la collectivité. Dit autrement, le service public fonctionnel n’est plus automatiquement presté par un service public organique.
De même, la fonction de régulation, remplie par les administrations qui en ont la charge, change de nature. En effet, le contexte concurrentiel assure lui-même, mais seulement pour partie cette fonction : la concurrence est effectivement, pour les opérateurs, un incitant à une nouvelle politique commerciale (de prix, de qualité,...). Dit autrement, la fonction de régulation doit être repensée. En particulier, il s’agit de voir comment organiser la prestation de service universel : quel système mettre en place et quels nouveaux rôles seront amenés à jouer les différents acteurs dont l’administration régulatrice?
Mais la question de la prestation et de la régulation du service universel - et donc des nouveaux rôles des administrations - renvoie à la question du cadre réglementaire. Quelles sont les éventails de choix étant donné le cadre réglementaire Européen ? Quelles sont les voies les plus porteuses ? Quels rôles sont actuellement dévolus aux administrations qui prestent ou régulent le service universel ? Quelles mutations dans ces rôles sont à attendre de l’ouverture à la concurrence et de la volonté publique d’organiser un service universel dans un tel environnement ? Ces questions sont loin d’être réglées. Voyons à cet égard l’avis motivé de la Commission Européenne envoyé à la France, seul pays à avoir déjà mis en place un système de financement du service universel.
OBJECTIFS
L’apport spécifique du projet se situe sur divers plans. D’abord, nous souhaitons élaborer un cadre théorique et en tester la pertinence en le confrontant à un autre service en réseau, celui de l’électricité. Cette confrontation sectorielle a pour but d’affiner le cadre général de réflexion en le rendant apte à des rapprochements nourrissant la réflexion concrète.
Un autre apport de la recherche est la confrontation des expériences nationales. En ce qui concerne le secteur des télécommunications, une comparaison des situations belge et française est sera effectuée par le CRID. En effet, ce pays est le seul à avoir lancé un financement du service universel. De plus, le système français a fait l’objet d’un avis motivé de la Commission Européenne, ce qui rend l’analyse riche de sens.
Le dernier apport de la recherche consiste en des propositions très concrètes tant sur le cadre réglementaire traitant du service universel que sur le rôle nouveau qui sera joué par les administrations en charge de la régulation de ce service. Ces propositions écrites porteront principalement mais non exclusivement sur le secteur des télécommunications. Elles seront communiquées aux partenaires de la recherche : les membres de cabinets ministériels et les membres des administrations.
Service universel et concurrence : les communications électroniques comme base à une réflexion générale sur le rôle des administrations régulatrices
Feron, Thibaut - Louveaux, Caroline Gent : Academia Press, 2003 (PB5903)
Service universel et concurrence dans les services de réseau: les télécommunications comme base à une réflexion générale : résumé
Bruxelles : SSTC, 2003 (SP1122)
[Pour télécharger]