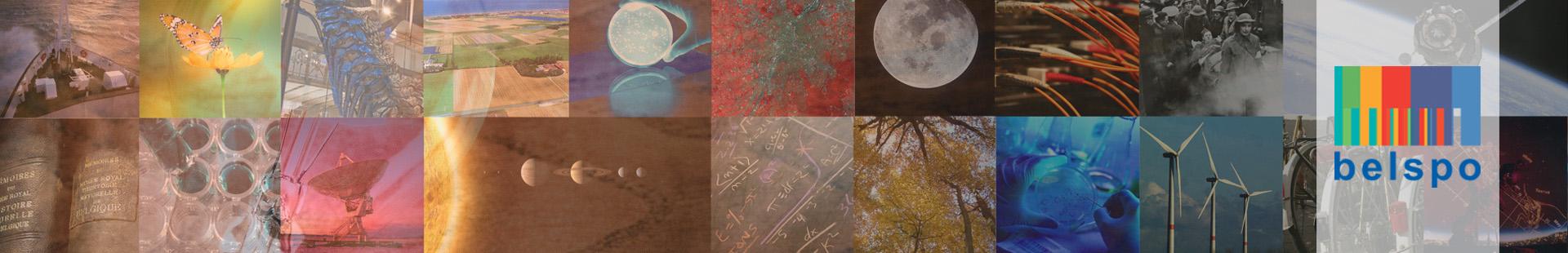
Projet de recherche B2/191/P1/MicroResist (Action de recherche B2)
DESCRIPTION DU PROJET
Les maladies transmises par les escargots (MTEs) affectent plus de 300 millions de personnes globalement, mais sont aussi la cause d’importantes pertes économiques et de mortalité pour le bétail. La schistosomiasis est une des infections tropicales les plus prévalentes en Afrique, avec près de 200 millions de personnes infectées en Afrique sub-Saharienne.
Malgré la disponibilité de moyens de diagnostic et de traitement adéquats, et de l’effort commun mis en place à ce jour pour contrôler la maladie, la schistosomiasis continue de (ré-)émerger en suivant une répartition géographique inattendue et avec une intensité sans précédent. La réalisation que l’administration massive de médicament ne suffit pas à elle seule à endiguer la maladie a restauré le focus sur le contrôle des escargots hôtes. Ces mesures se focalisent sur l’élimination locale des populations d’escargots. Cependant, cette méthode a pour effet non seulement d’être nocive pour d’autres organismes aquatiques tels que les poissons et les amphibiens, mais aussi de causer la perte d’importantes composantes des écosystèmes affectés. La réponse immunitaire des escargots à une infection est influencée par des facteurs génétiques, par des paramètres environnementaux abiotiques tels que la température, et par des facteurs biotiques comme le microbiome associé à l’escargot hôte, qui est de plus en plus reconnu comme un facteur important. Les études des microbiomes des gastropodes sont cependant très rares, malgré leur importance médicale. De plus, ces études se sont concentrées sur des expériences d’infection unique, alors que dans la nature, un même hôte peut être infecté par plusieurs parasites.
A travers ce projet, nous désirons préparer le terrain pour le développement de nouvelles stratégies de contrôle biologique durables ayant pour but de combattre les maladies tropicales négligées, en générant de nouvelles données expérimentales concernant les microbiomes des escargots hôtes en utilisant le ‘métabarcoding’ du 16S sur des gastropodes infectés naturellement (collection de musée) et infectés artificiellement. Plus spécifiquement, les objectifs du projet sont les suivants : 1) caractériser le microbiome d’une sélection d’espèces de gastropodes qui actent comme hôtes pour la schistosomiasis et la fasciolosis en Afrique et tester l’impact de la phylogénie, de la géographie et du statut d’infection ; 2) de tester les variations de microbiomes sur le court et long terme, pour les espèces sélectionnées, en cas d’infections multiples and ; 3) d’analyser expérimentalement les corrélations observées à travers les deux premiers objectifs, afin d’identifier les relations de causalité en jeu. Ce dernier point sera abordé par le biais d’expérience de transplantation. Nous avons sélectionné Bulinus truncatus du Sénégal comme organisme pour cette expérience car cette souche présente une variation de susceptibilité envers Schistosoma haematobium au sein de la même rivière, avec des populations de la partie inférieure de la vallée de la rivière Sénégal étant résistantes aux infections, au contraire de populations située 40 km plus loin, en milieu de vallée. Quatre génotypes de Bulinus truncatus (deux susceptibles et deux résistants) seront utilisés comme donneurs de microbiomes de tubes digestifs pour quatre autres génotypes (deux susceptibles et deux résistants) (voir Fig. 1 pour une visualisation du schéma expérimental).
Les génotypes receveurs sont dans un premier temps rendus axéniques ou libres de microbiome en utilisant le protocole décrit par Chernin en 1957, afin d’éliminer les potentiels effets de priorité. La connaissance des microbes qui peuvent promouvoir la résistance permet l’ingénierie de communauté microbienne bénéfique, qui éliminerait dans les faits le besoin de molluscicides détrimentaux. Ceci permettrait de développer des stratégies de contrôle des escargots à la fois durables et respectueuses de l’environnement, et basées sur l’exploitation de ressources naturellement accessibles. Par exemple, la capacité de microbiomes à influencer la susceptibilité d’un vecteur a été exploitée dans le contrôle de la malaria en utilisant des stratégies similaires à celle décrite. Ces stratégies incluent l’utilisation de pathogène des insectes qui diminuent la population de vecteurs, ou l’introduction de bactérie et de mycètes réduisant la capacité des populations de moustiques. Une autre option est la paratransgénie ; transgénie d’un symbionte du vecteur pour éliminer un pathogène d’une population de vecteurs.