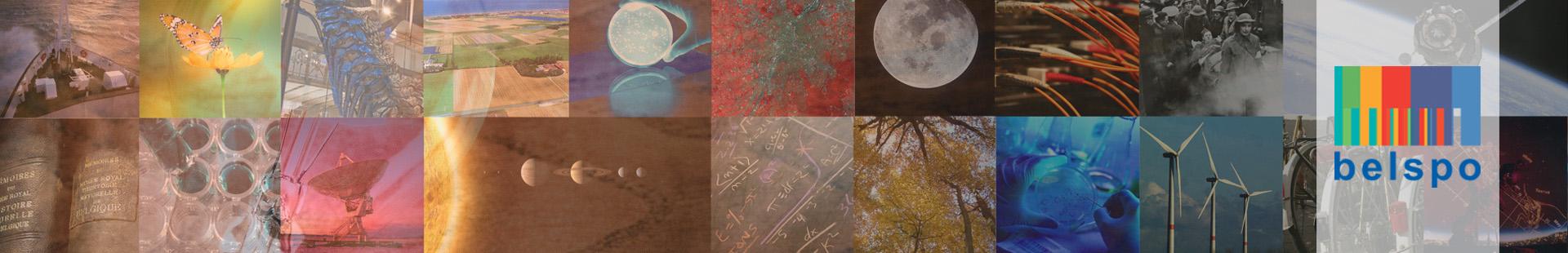
Projet de recherche B2/202/P3/EPIBEL (Action de recherche B2)
EPIBEL vise à identifier et à expliquer les inégalités produites par la COVID-19 en l’inscrivant dans l'histoire des pandémies en Belgique. Une pandémie comme celle de la COVID-19 peut toucher n'importe qui, mais le risque de maladie grave et de décès n'est pas identique pour tous. Son impact est probablement très différent selon la profession, le lieu de résidence, l'âge, le revenu, etc. Cependant, nous savons encore peu de choses sur ces inégalités, notamment sur leur évolution à long terme. La COVID-19 n'est pas la première pandémie majeure. C'est pourquoi EPIBEL compare systématiquement les impacts socio-économiques et démographiques de la COVID-19 avec ceux de cinq épidémies anciennes : la grippe "espagnole" de 1918/19, l'épidémie de choléra de 1866, la dysenterie de 1692/93 et les pestes de 1438/39 et 1556/59. Ces événements étaient déjà reconnus par leurs contemporains comme particulièrement meurtriers. Ils sont relativement bien documentés (les données existent et des textes de l’époque en parlent) et ont contribué au développement de la politique et du savoir-faire en matière de maladies épidémiques. EPIBEL vise à exploiter la "mémoire pandémique" de la Belgique, en mettant l'accent sur les inégalités en matière de vulnérabilité et de résilience. Quatre équipes de recherche belges de premier plan ont uni leurs forces à cette fin : AIPRIL – the Antwerp Interdisciplinary Platform for Research into Inequality (Tim Soens, coordinateur d’EPIBEL), UGent Quetelet Centre for Quantitative Historical Research (Isabelle Devos), UCL Center for Demographic Research (Thierry Eggerickx) et Centrum voor Stadsgeschiedenis (Hilde Greefs).
EPIBEL s’est fixé cinq objectifs, chacun d'entre eux correspondant à un Work Package (WP) spécifique :
• Le WP1 a pour objectif d’identifier qui est décédé des suites de la COVID-19 et pourquoi certains groupes ont été plus touchés que d'autres. À cette fin, EPIBEL associe les données du Registre national à celles des recensements de population et des bulletins de décès de l’état civil. EPIBEL proposera une analyse de la mortalité liée à la COVID-19 sur les plans socio-démographiques et spatiaux.
• Le WP2 étudie en quoi les inégalités de mortalité face à la COVID-19 diffèrent des inégalités de mortalité face aux pandémies précédentes. Grâce aux bases de données HISSTER (pour 1866 et 1918/19) et STREAM (pour 1692/93), EPIBEL peut compter sur des données exceptionnelles qui devront être étendues et affinées pour les épidémies sélectionnées. Pour un échantillon de villes et de régions rurales, le profil social des victimes sera analysé sur la base des registres des causes de décès, des registres paroissiaux, des comptes des églises et des données cadastrales (POPPKAD). Ces analyses seront complétées par une analyse spatiale des conditions de vie locales.
• Le WP3 examinera l'impact de ces pandémies historiques sur l'emploi et les revenus, afin de comprendre les relations entre les inégalités socio-économiques et les inégalités de mortalité. Les données statistiques sur le marché du travail, les salaires et la longévité seront combinées dans une analyse plus approfondie pour quelques villes/régions spécifiques.
• EPIBEL cherchera également à comprendre comment les services sociaux et les politiques de lutte contre la pauvreté ont pu influencer/moduler l'impact des pandémies sur les groupes les moins privilégiés de la société (WP4). EPIBEL combinera donc des données statistiques sur la pauvreté avec une recherche archivistique approfondie sur A) l'organisation des services sociaux ; B) la nature de l'aide ; C) les bénéficiaires de l'aide et D) le débat public sur les services sociaux et les politiques de lutte contre la pauvreté pendant et après les pandémies.
• Enfin, le WP5 se concentrera sur le rôle de la politique, des mesures dites “non pharmaceutiques” (confinement, gestes barrières…) à la politique fiscale. Grâce à l’identification des acteurs impliqués et à l'analyse qualitative de la politique et du débat public (par le biais de rapports, de comptes-rendus de réunions, de réglementations, etc.), ce WP étudiera comment certaines politiques ont pu influencer la vulnérabilité et les inégalités en terme de résilience en temps de pandémie.
Résultats et impact attendus :
EPIBEL intègre la COVID-19 dans la longue histoire des épidémies en Belgique, avec un accent particulier sur la vulnérabilité et les inégalités en termes de résilience. À cette fin, EPIBEL développera cinq outils de travail présentant un intérêt particulier pour la recherche et les politiques:
(1) un aperçu historique actualisé des foyers mortels de maladies épidémiques en Belgique/au sud des Pays-Bas,
(2) les profils socio-économiques et démographiques de la mortalité épidémique de la Peste à la COVID-19,
(3) un atlas des épidémies et des inégalités,
(4) des indicateurs de l'emploi, de l'aide sociale et de la mortalité avant, pendant et après les épidémies,
(5) une matrice politique avec des mesures et leur impact sur la mortalité, la vulnérabilité et la résilience.
Les résultats seront communiqués par le biais d'articles scientifiques et de notes brèves semestrielles.
En outre, EPIBEL traduira ses résultats en présentations et outils destinés à différents groupes cibles, des écoles (secondaires) sur les soins de santé aux historiens de la famille.
De cette manière, EPIBEL veut contribuer au développement d'une mémoire pandémique en Belgique. Ce faisant, EPIBEL souhaite contribuer à l’élaboration et au renforcement d’un système de veille durable pour les futures pandémies et dans l'élaboration de politiques qui tiennent compte de l'impact inégal des pandémies, afin de réduire la vulnérabilité et de renforcer la résilience de la société.