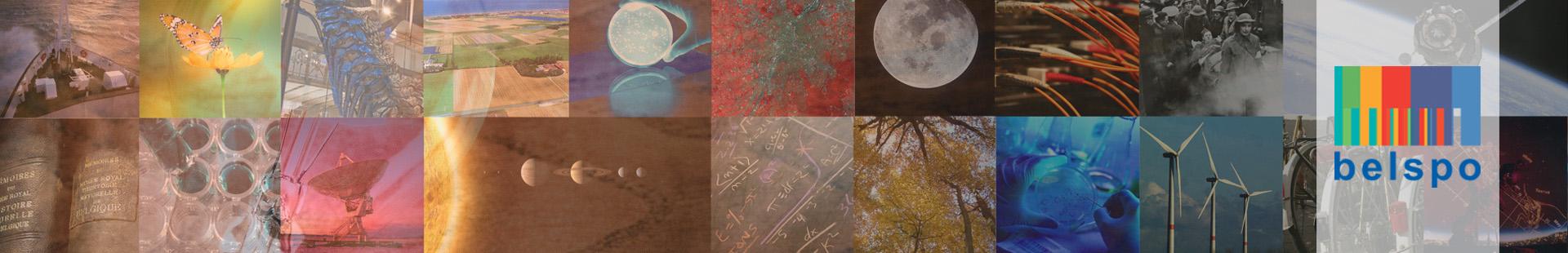
Projet de recherche B2/212/P1/HabitAnt (Action de recherche B2)
Les modèles couplés du climat et du système Terre prédisent une augmentation des températures et une modification des régimes de précipitations en Antarctique Maritime et sur les zones côtières continentales, ce qui entraînera probablement une augmentation de la fonte glaciaire, l'expansion des zones libres de glace, une connectivité croissante entre régions et des changements hydrologiques. Les effets de ces changements sur la biodiversité terrestre et aquatique sont susceptibles de provoquer une homogénéisation entre les régions, l'extinction de certains taxons et la propagation d'espèces envahissantes. Or, les biotes terrestres et lacustres de l'Antarctique sont plus distincts et structurés biogéographiquement qu'on ne le croyait auparavant. Ces observations se basent sur les niveaux élevés d'endémisme et les distributions restreintes dus à la diversification des taxons dans des refuges glaciaires isolés pendant de longues périodes. La localisation de ces refuges repose en grande partie sur les données de biodiversité et les phylogénies moléculaires du biote contemporain. Mais dans certains cas, les données biologiques ne concordent pas avec les reconstitutions de l'histoire des déglaciations basée sur les données géologiques. Cette disparité doit donc être abordée par une recherche interdisciplinaire combinant des approches issues des sciences biologiques et géologiques.
HabitAnt vise à étudier l'habitabilité passée, présente et future des lacs et de leurs bassins versants sur la côte est de l'Antarctique. Cela sera basé sur l'élucidation des processus clés qui ont contribué à la structure actuelle des communautés, y compris la persistance à long terme du biote dans les refuges glaciaires, et l'extinction, la colonisation, la diversification et la succession biologique en réponse aux changements environnementaux au cours des 130000 dernières années. Plus précisément, nous visons à (1) identifier la présence de refuges glaciaires locaux, y compris ceux situés sous le niveau actuel de la mer, (2) déduire l'histoire évolutive récente de certains biotes-clés lacustres et terrestres appartenant à différents groupes fonctionnels et taxonomiques, (3) étudier l'assemblage des espèces et la succession biologique dans des lacs formés après la déglaciation et leur réponse au réchauffement climatique, et (4) utiliser ces informations paléoécologiques, en combinaison avec les inventaires existants des données de distribution récentes, pour prédire la réponse de ces communautés aux changements climatiques futurs.
Nos études seront basées sur des carottes datées avec précision de sédiments lacustres de trois régions de l'Antarctique continental avec une histoire de déglaciation contrastée. Nous analyserons l'ADN ancien (ADNa), les microfossiles et une suite de proxys sédimentologiques et biogéochimiques, y compris un proxy quantitatif de paléotempérature et des pigments photosynthétiques fossiles. Nous concentrerons nos analyses paléoécologiques sur trois fenêtres temporelles, à savoir l'interglaciaire Eémien, la dernière période glaciaire et l'Holocène. Les données sur l'ADN et les microfossiles seront associés à des données récentes sur les communautés lacustres actuelles de l'Antarctique. Cela nous permettra d'étudier si des taxons actuellement limités au Sub-antarctique et l'Antarctique maritime ont pu coloniser les oasis libres de glace du continent pendant les périodes chaudes passées.
Les extinctions et la survie des taxons au cours de la dernière période glaciaire seront étudiées dans les sédiments des interglaciaires Eémien à Holocène. Avec l'étude des bassins sous-marins contenant des sédiments terrestres et de (paléo)lacs du Pléistocène supérieur et de l'Holocène inférieur, cela nous permettra d'identifier la présence de refuges glaciaires locaux (cachés). Des analyses phylogénétiques avec horloge moléculaire de cyanobactéries, protistes et invertébrés sélectionnés seront utilisées pour inférer leur histoire évolutive. Ces ensembles de données nous permettront de modéliser l'optimum et la tolérance des taxons-clés par rapport à la température et autres paramètres environnementaux pertinents.
Ces travaux contribueront à résoudre des énigmes concernant la vie dans les environnements terrestres et lacustres de l'Antarctique. L'inclusion des paléolacs sous-marins nous permettra d'identifier les régions qui ont agi comme des refuges glaciaires, ce qui pourrait conduire à une révision des refuges proposés sur le continent. Ces données seront utiles pour la conservation de la biodiversité et appuyer les décisions prises par les réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique et pour les programmes scientifiques du SCAR actuels et futurs. Les souches cyanobactériennes seront déposées dans la collection publique BCCM/ULC, et les données moléculaires seront publiées dans des bases de données publiques.
Les résultats seront publiés dans des revues internationales à comité de lecture et présentés lors de réunions scientifiques internationales et de sessions spéciales organisées par les partenaires. Nos résultats seront communiqués au grand public et aux étudiants grâce à des activités de sensibilisation et des cours universitaires. Nos données de biodiversité seront disponibles via le « Antarctic Master Directory » et pourront être utilisées plus tard dans des modélisations pour prédire la réponse des communautés lacustres de l'Antarctique dans des scénarios de changements climatiques futurs.