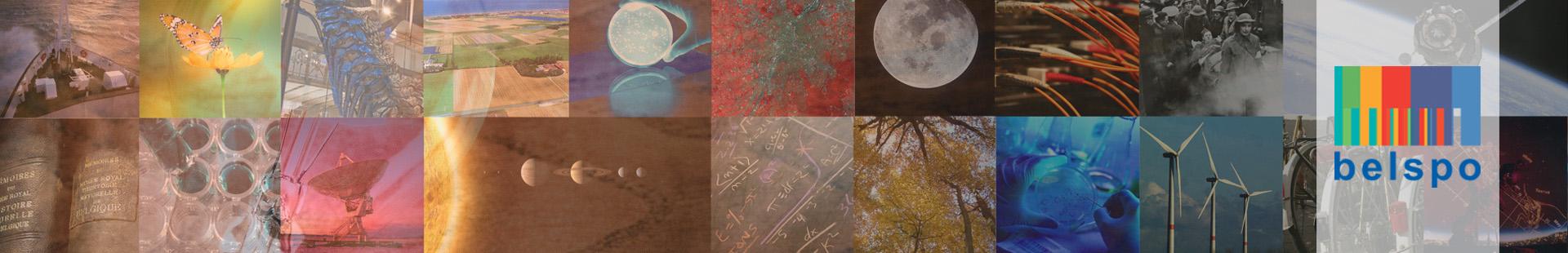
Projet de recherche EV/16 (Action de recherche EV)
La perte et l’isolement des habitats, associés à la conversion de terres pour les activités humaines sont reconnus comme le moteur principal de la dramatique réduction de la biodiversité sur Terre.
Les efforts de conservation traditionnels, à petite échelle -axés sur des espèces ou des lieux- ont récemment été reconnus comme largement insuffisants pour préserver le gros de la biodiversité de manière plus durable. En conséquence, la biologie de la conservation s’est orientée vers des approches au niveau du paysage, incluant les réseaux écologiques.
Il y a un besoin évident d’une procédure robuste et scientifique pour évaluer l’efficacité de différents scénarios de réseaux de conservation vis-à-vis d’une série d’espèces (cibles) et de leurs habitats.
La dispersion était auparavant largement considérée du point de vue de la population source, c’est-à-dire comme une forme de mortalité. Elle est maintenant reconnue comme un processus majeur permettant aux populations fragmentées de surmonter les extinctions locales, dont la probabilité augmente avec la diminution de taille de la tache d’habitat. Modéliser la dynamique d’une métapopulation est un défi scientifique majeur, dont le but est d’estimer sa viabilité dans des conditions particulières. De tels modèles doivent intégrer des caractéristiques de l’espèce et des caractéristiques du paysage : ils sont appelés « spatialement explicites ». Les modèles actuels de métapopulations traitent le paysage comme une carte où chaque parcelle (pixel de la carte) est soit habitable (tache d’habitat) ou ne l’est pas (matrice entourant les taches d’habitat; on suppose que la dispersion peut se produire à travers cette matrice - la connectivité n’est pas nulle). Ces modèles ignorent également en général la dynamique locale des populations de manière que la dynamique de la métapopulation ne dépend que des taux d’extinction et de recolonisation.
Le but de ce projet est d’appliquer une approche modélisatrice spatialement réaliste et d’introduire dans les modèles de métapopulations la dynamique locale des populations.
Ceci signifie d’une part que la structure du paysage sous-jacente au modèle sera celle d’une zone cible réelle; les taches d’habitat seront distribuées sur cette zone et un indice de connectivité sera calculé et cartographié avec l’aide d’un Système d’Information Géographique sur base de données d’occupation du sol et d’autres variables environnementales pertinentes. L’indice de connectivité développé par l’équipe de l’UA sera appliqué et l’expertise en SIG de l’équipe de l’UCL nous permettra de construire la carte de paysage pertinente.
D’autre part, les études à long terme menées par les deux équipes sur des populations de papillons et de rongeurs ont déjà produit des jeux de données très importants qui permettront une modélisation précise de la démographie de ces espèces. L’équipe de l’UCL est spécialisée dans l’analyse de données obtenues par Capture-Marquage-Recapture.
Finalement, un ingrédient important des modèles de métapopulations est le taux de dispersion. Celui-ci est cependant extrêmement difficile à évaluer même si l’on utilise des méthodes de radio-pistage -parce que la dispersion est un événement rare. L’équipe de l’UA est experte en techniques de génétique moléculaire qui permettront d’évaluer la dispersion dans les populations étudiées.
Le résultat attendu de ce projet est une estimation d’espérance de vie des métapopulations, de la probabilité de leur survie sur de longues périodes de temps (100 ans) et du risque de perte de variabilité génétique, sous différents scénarios de restauration des habitats, afin de fournir des directives et des critères pour évaluer la capacité d’un paysage à conserver la biodiversité.
Méthodologie
1. Dynamique des populations: Des méthodes standardisées de capture-marquage-recapture, adaptées à chaque espèce cible, sont utilisées.
2. Description de la dynamique des populations: Les paramètres démographiques (taux de survie et recrutement) des populations locales sont estimés en utilisant la méthode «high-tech» des modèles sous contraintes paramètrés à l’aide de données de capture-marquage-recapture.
3. Estimation des taux de dispersion: pour les papillons, l’observation directe des mouvements entre taches d’habitat est possible; pour les mammifères, le radio-tracking le permet occasionnellement mais nous utiliserons principalement les méthodes moléculaires pour identifier les immigrants. Il s’agira de comparer leur "signature génétique" au profil génotypique de la population locale.
4. Evaluation de la connectivité et de la qualité de l’habitat. Les sites d’étude sont cartographiés (végétation et caractéristiques physiques). A l’aide de l’outil S.I.G. et des modèles d’occupation des taches d’habitat et de coût-distance, des cartes de qualité de l’habitat et de résistance au déplacement sont produites pour chaque espèce cible. Ces cartes sont utilisées ultérieurement dans les modèles de dynamique des populations.
Interactions entre les différents partenaires
Ce projet est interdisciplinaire. Les équipes de l’UIA et de l’UCL possèdent des compétences reconnues dans des domaines complémentaires qu’elles investissent et partagent dans ce projet (par exemple, des formations mutuelles sont organisées). L’UIA apporte son savoir-faire en biologie moléculaire et en modélisation des coûts de déplacement. L’UCL apporte ses compétences dans l’estimation des paramètres démographiques et dans l’analyse de la viabilité des populations. Les deux équipes disposent de jeux de données pluriannuels portant sur plusieurs espèces (papillons, rongeurs) dans différents paysages.
Résultats/produits attendus
Ce projet doit permettre de développer un outil d’estimation du délai avant l’extinction d’une métapopulation, de sa probabilité de persistance et du risque de perte génétique selon différents scenarii de restauration. Cet outil permettra de fournir des lignes directrices en aménagement du territoire dans le but d’aider à la conservation de la biodiversité.
En aucune façon, la méthodologie proposée ici n'apportera une solution globale au problème de la conservation de la biodiversité au niveau du paysage. Un paysage doit abriter un ensemble d'écosystèmes durables et ne doit pas permettre seulement le maintien de quelques espèces emblématiques. Cette étude devra donc être conduite simultanément chez plusieurs modèles biologiques représentatifs de différents groupes fonctionnels. Une structure paysagère favorisant une espèce, peut être néfaste pour une autre espèce. Le scénario sélectionné sera donc nécessairement un compromis. Notre projet doit être perçu comme une première étape vers la définition de structures du paysage permettant une conservation optimale de la biodiversité.
Partenaires
Activités
Eric Le Boulengé: Notre objectif est de comprendre et de modéliser les processus impliqués dans la dynamique des populations. Nous sommes spécialisés dans l’estimation des paramètres démographiques, la planification expérimentale, et les méthodes d’analyse.
Michel Baguette: Des projets d’étude de l’écologie et la génétique des populations sont menés chez différents taxons depuis 1994. Notre objectif est d’étudier les mécanismes responsables de l’adaptation des populations aux pressions sélectives d’un environnement changeant et hétérogène.
Erik Matthysen: Nous étudions le fonctionnement des populations animales et particulièrement les interactions individu-processus populationnels. Les questions fondamentales abordées sont l’adaptation des traits comportementaux et écologiques et les processus micro-évolutifs. D’un point de vue appliqué, nous étudions l’impact des changements environnementaux sur les populations.
Coordonnées
Eric Le Boulengé
Centre de Recherche sur la Biodiversité,
Unité d'Environnemétrie et de Géomatique
Place Croix du Sud, 2, B.P. 16,
B-1348 Louvain-la-Neuve
leboulenge@enge.ucl.ac.be
www.agro.ucl.ac.be/enge/staff/curr/Leboulenge/
Michel Baguette
Centre de Recherche sur la Biodiversité,
Unité d'Ecologie et de Biogéographie
Place Croix du Sud, 4
B-1348 Louvain-la-Neuve
baguette@ecol.ucl.ac.be
http://www.ecol.ucl.ac.be/bcop/baguette/
Erik Matthysen
Universiteit Antwerpen - Departement Biologie - Laboratoire d'Ecologie animale
B-2610 Antwerpen
matthys@uia.ac.be
http://www.uia.ac.be/u/matthys/
Comité d'Utilisateurs
Prof. dr. Paul Opdam
ALTERRA, Research Institute voor de Groene Ruimte
Postbus 47, NL-6700 AA Wageningen (Pays-Bas)
p.f.m.opdam@alterra.wag-ur.nl
Dr Geert De Blust
Institute of Nature Conservation
Kliniekstraat 25
B-1070 Bruxelles
geert.de.blust@instnat.be
Dr Marc Dufrêne
Centre de recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
Ministère de la Région Wallonne
Avenue Maréchal Juin, 23
B-5030 Gembloux
M.Dufrene@mrw.wallonie.be