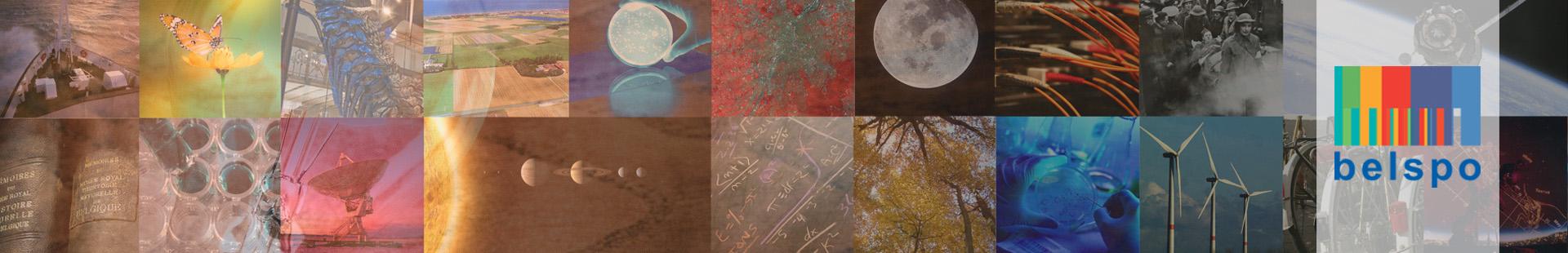
Projet de recherche P4/12 (Action de recherche P4)
Le réseau étudie les mécanismes selon lesquels les habitats indigènes se sont développés en sociétés urbanisées, durant la période romaine, dans les régions orientale et occidentale de l'Empire, et finalement sont tombées en décadence (archéologie de l'occupation du sol). L'enquête interdisciplinaire sert ici à définir le rôle du milieu (paléoécologie) et de son exploitation par l'homme (paléoéconomie). Dans cette perspective, elle s'oriente tout naturellement vers l'étude de l'usage des matières premières (pierre, argile) et des restes d'animaux.
Du point de vue chronologique, le réseau concerne la période hellénistique jusqu'au début de la période byzantine dans la partie est, et de la fin de la République au début du Moyen-Age dans la partie ouest. Du point de vue géographique, deux régions ont été sélectionnées: le Nord de la Pisidie (Turquie) avec les fouilles et les prospections de la KUL à Sagalassos pour l'Est et le Nord de la Gaule et la Rhénanie, zone d'étude de l'UCL, pour l'Ouest. Étant donné le fait que ces deux régions furent en contact avec le monde romain, de manière quasi simultanée, l'étude de deux districts ayant des antécédents différents (hellénistiques à l'Est et celtiques à l'Ouest) doit pouvoir conduire à réaliser une étude comparative des mécanismes de la romanisation et de la mobilité sociale dans l'Empire romain, du rôle joué par l'économie et le commerce et de l'impact produit par et sur le milieu naturel. Les deux régions ont traversé une crise politique et économique grave durant le IIIe siècle, suite aux invasions et à des troubles internes. A l'Ouest, cela a mené à l'implantation de tribus germaniques fortement romanisées; à l'Est, la christianisation a conduit à la mise en place d'une nouvelle société à caractère grec. Le réseau enquête donc sur la manière dont ces changements ont influencé l'urbanisation, l'économie et le milieu naturel de ces deux zones géographiques.
L'étude de l'environnement constitue un important thème de recherche du groupe d'étude de la KUL et de l'UCL. Cela comprend l'examen de l'influence du milieu physique, des processus géomorphologiques, des changements dans l'approvisionnement en eau, des modifications du climat, sur le développement des établissements humains. La recherche se tourne aussi vers les restes de micro- et de macro-faune en tant qu'indicateurs du milieu naturel; il s'agit là du domaine de recherche du MRAC/KMMA. L'interprétation paléoécologique des restes d'animaux est utilisée dans une optique interdisciplinaire, en tenant compte des données géomorphologiques, pédologiques et paléobotaniques. Les mêmes restes sont également étudiés en vue d'une reconstruction de la faune et de son exploitation dans les zones de l'Est et de l'Ouest. Il s'agit de déterminer le rôle des animaux dans l'alimentation, le transport et dans d'autres activités. C'est pourquoi le MRAC/KMMA est activement impliqué dans le travail de terrain des deux universités.
A côté de l'étude faunistique, celle des matières premières forme également un champ de recherche important du réseau. Tant la KUL que l'UCL, possèdent une grande connaissance de l'argile, des productions et du commerce des céramiques, appliquée respectivement à la sigillée, à la céramique à enduit rouge et à la céramique commune locale de l'Est et de l'Ouest. Le réseau vise à développer des études comparatives et une méthode de recherche commune concernant l'origine, la technologie, la fonction et les schémas de production des céramiques locales et régionales. Il sert aussi à promouvoir une plus grande intégration des recherches archéométriques dans les deux universités, afin de faciliter les comparaisons inter-régionales.
L'étude de tous ces thèmes exige l'expérimentation de nouvelles méthodes, et la mise au point de nouvelles stratégies d'investigation et de techniques analytiques dans un environnement interdisciplinaire, démarche qui finalement pourra être appliquée à un contexte géographique et chronologique plus large.