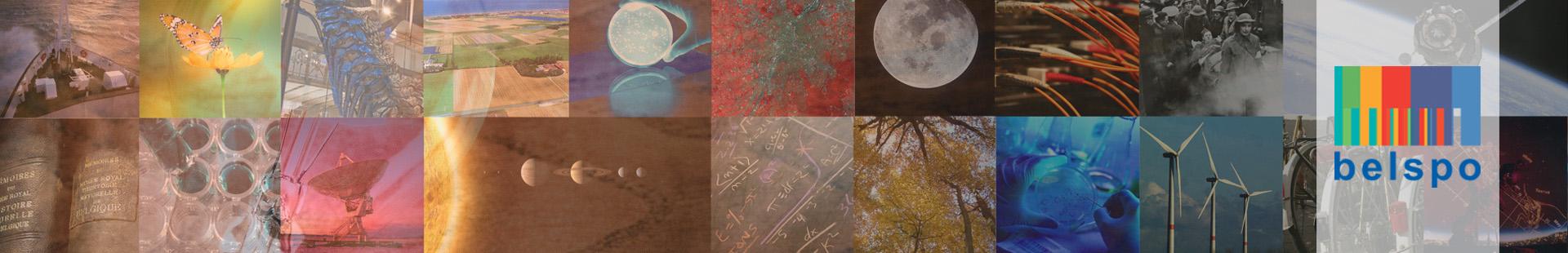
Projet de recherche P6/32 (Action de recherche P6)
Le projet cherche à tirer profit du savoir-faire déjà acquis (cf. le programme PAI V/10 : http://www.ulb.ac.be/philo/urbs/), mais aussi à élargir et à rajeunir son réseau d’équipes de recherches. La longue expérience en matière d’histoire urbaine qui existe dans différentes universités et institutions de Belgique (et aussi aux Pays-Bas, associés au projet via la collaboration avec l’Université d’Utrecht) sera réunie et mobilisée en vue de l’exploration de sujets reflétant les courants actuels de la recherche historique, dans le but d’évaluer l’apport des innovations méthodologiques. Le cadre chronologique du projet, plus large qu’auparavant, comportera tout le bas moyen âge et surtout toute la période des temps modernes, ce qui permettra d’insister sur les processus à long terme (ca. 1200-1800).
Nous proposons trois grands axes de recherches dont les thèmes relèvent d’une approche spatiale et socio-culturelle de l’histoire urbaine : (1) l’espace urbain, (2) savoirs et culture, (3) le capital social. Certains de ces éléments thématiques ont déjà été étudiés dans le cadre de la phase précédente du PAI ; conformément aux suggestions formulées lors de l’évaluation du PAI V/10, ils seront dorénavant lus à la lumière comparative de la recherche internationale et dans une optique résolument interdisciplinaire (grâce à l’intégration d’historiens de l’art, d’historiens du livre et de géographes).
La composition des équipes (Université de Gand, Université Libre de Bruxelles, Université d’Anvers, Bibliothèque Royale, Musées Royaux des Beaux-Arts et Université d’Utrecht) s’est faite en fonction des compétences disponibles, mais aussi avec l’objectif d’ouvrir la recherche aux études culturelles, au sens large et interdisciplinaire du terme (d’où l’incorporation de l’équipe des Musées des Beaux-Arts), et d’explorer les liens entre économie urbaine et diffusion des savoirs (d’où le choix de l’équipe d’Utrecht comme partenaire européen). Tous les partenaires belges impliqués dans le précédent PAI s’engageront dans le nouveau programme. Le partenaire européen de la phase V, l’Université de Leiden, n’y participera plus de manière institutionnelle, mais nous continuerons de collaborer de manière intense avec ses chercheurs sur certains thèmes spécifiques, tels le rôle de la noblesse ou les représentations de la société urbaine. Cette politique de « continuité dans le changement » s’exprime aussi dans le désir de tous les acteurs de poursuivre les rapports avec les membres du jury d’experts qui a accompagné la phase précédente du programme. Les recherches proposées dans les trois axes profiteront toutes d’apports de la part de projets connexes (qu’il s’agisse de recherches collectives ou individuelles) financés par d’autres sources et révélateurs du travail réalisé par les différentes équipes dans le cadre des précédentes phases du PAI.
Le nouveau projet vise à apporter une contribution substantielle à un domaine pour lequel la Belgique jouit d’une reconnaissance internationale depuis des générations. Plusieurs parmi les sujets de recherches retenus sont d’une importance capitale pour la compréhension de la société d’aujourd’hui, des problèmes liés à la mondialisation et à l’urbanisation massive du monde, notamment. En insistant sur des thèmes comme la dissémination et l’application des savoirs, les processus d’inclusion et d’exclusion au niveau des marchés du travail et des espaces socialement utiles, nous posons des questions essentielles qui font écho aux défis que toutes les sociétés urbanisées d’aujourd’hui doivent relever.
1. L’espace urbain
Deux thèmes seront au centre de ce premier axe de recherches : les espaces urbains et les transformations qu’ils connaissent, d’une part, les réseaux urbains qui s’y déploient, d’autre part. Ces thèmes ont été abordés pendant les phases précédentes du PAI dans une approche statique, centrée sur l’étude des hiérarchies urbaines ; à l’avenir, nous proposons d’accorder plus d’attention au mouvement, c’est-à-dire à l’organisation dynamique de l’espace à l’intérieur et à l’extérieur des villes. La recherche sur les apports des ressources naturelles et des infrastructures matérielles au développement de réseaux urbains efficaces sera approfondie et intégrée dans une étude plus générale des forces politiques et sociales à l’œuvre en milieu urbain. Le nouveau projet vise à mettre en évidence le rôle joué par les nombreux réseaux de solidarité et d’influence sociaux, économiques, politiques, culturels et religieux. Des recherches ponctuelles seront consacrées à la mobilité des élites commerciales et des artisans (notamment des imprimeurs et des artistes). L’extension chronologique du projet à la période moderne et son ouverture géographique nous amèneront à poser la question des liens avec les réseaux politiques plus larges qui existent au niveau des vastes ensembles sous domination espagnole, puis autrichienne. Le thème de la représentation des villes et du paysage, qui sera décliné par l’équipe des Musées des Beaux-Arts, soustendra aussi d’autres projets de recherches : un premier sur les dessins du 16e siècle, un deuxième sur comment représenter aujourd’hui, grâce à l’outil cartographique, les réalités du passé. D’un point de vue méthodologique, la phase V du PAI a en effet permis de mettre le doigt sur le manque de bonnes cartes dans le domaine de l’histoire urbaine. Au courant de la phase VI du programme, plusieurs chercheurs ayant une expertise en histoire, en géographie et en informatique contribueront à la réalisation, à titre expérimental et par le recours aux nouvelles techniques de digitalisation, d’instruments cartographiques qui répondent aux exigences scientifiques d’aujourd’hui.
2. Savoirs et culture
Un important changement de perspective dans le domaine de l’histoire urbaine a mis en avant l’étude des représentations culturelles des groupes sociaux. Ce nouveau paradigme a déjà marqué les recherches menées dans le cadre de la phase précédente du programme, qui a notamment mis l’accent sur la construction des identités et des idéologies urbaines. Le deuxième axe de recherches posera des questions d’ordre socio-économique et culturel en s’inspirant de cette expertise ; il prendra comme point de départ le rôle-clé des groupes intermédiaires dans les villes des Pays-Bas. L’accent sera mis sur comment le ‘capital culturel’ (le fait de savoir lire et écrire, les compétences intellectuelles et artistiques, les savoirs théoriques et pratiques) s’acquiert, se reproduit et se transforme grâce à l’intervention des groupes intermédiaires. Il s’agira de mettre à jour les contributions du ‘capital culturel’ aux processus de changement de la société urbaine. La diffusion des savoirs théoriques et pratiques (c’est-à-dire appliqués, d’où l’attention accordée aux groupes producteurs d’objets d’art) sera étudiée à partir de plusieurs angles de vue, avec comme fil conducteur le débat sur l’émergence précoce d’une économie de la connaissance. L’étude de la circulation des idées politiques et religieuses dans le contexte urbain, et plus particulièrement des média et des formes matérielles grâce auxquelles les idéologies se diffusent, s’inscrira aussi dans le deuxième axe de recherches. Elle permettra d’établir des rapports avec les interrogations sur l’identité urbaine, sa construction, ses transformations et ses adaptations aux changements de contexte.
3. Le capital social
Inspiré par la recherche en sociologie et en anthropologie, le troisième axe de la nouvelle phase du PAI s’inscrira dans la continuité par rapport à la phase précédente (qui a mis l’accent sur le processus de civilisation et sur le comportement émotionnel des citadins). Il sera centré sur deux thèmes, la formation du capital social, d’une part, la nature du capital social, d’autre part. L’étude des réseaux sociaux sera la principale préoccupation des chercheurs fédérés dans ce groupe de travail. Les historiens doivent tenir compte de la vie quotidienne des acteurs de l’histoire, tout en continuant à s’interroger sur les interactions entre ceux-ci et des processus qui se déploient sur le long terme, comme la centralisation politique, l’affirmation du capitalisme marchand, l’évolution des modes de consommation, l’urbanisation (ou la dé-urbanisation) et l’impact des institutions sur le développement économique. Plusieurs projets de recherches aborderont des sujets liés à ces problématiques : la manière dont fonctionnent les groupes sociaux intermédiaires (étude des clubs, des confréries et des corporations) ; les stratégies qu’ils mettent en œuvre pour régler les conflits ; les éléments d’identité socio-culturelle qui sont essentiels pour la vie urbaine ; l’intégration des groupes intermédiaires dans des ensembles politiques plus grands (tels l’État ou la cour) par le biais de leur production artistique ou artisanale. Ici aussi, la chronologie élargie et l’approche interdisciplinaire multiplieront les possibilités de comparaison, au sein de l’espace des Pays-Bas et avec les autres régions fortement urbanisées de l’Europe. Des recherches complémentaires, menées dans le cadre d’autres projets, apporteront une plus-value importante.
Les thèmes de recherches proposés contribueront à éclairer la place à part que les Pays-Bas occupent dans l’histoire européenne en tant que société pour laquelle le phénomène urbain est de la plus haute importance. Le nouveau projet s’alignera davantage que les phases précédentes du PAI sur les développements récents dans le domaine académique ; il apportera la masse critique nécessaire pour l’élaboration de programmes pédagogiques novateurs (cf. l’implication des équipes dans les formations de maîtrise et dans les écoles doctorales) et répondra aux attentes du public à la recherche de connaissances scientifiquement fondées sur le passé. La collaboration aux projets de création de plusieurs musées d’histoire de villes, qui aboutiront au courant de la prochaine phase du PAI, est une preuve de ce besoin croissant en éléments historiques permettant de comprendre les processus sociaux à l’œuvre aux niveaux local et régional.