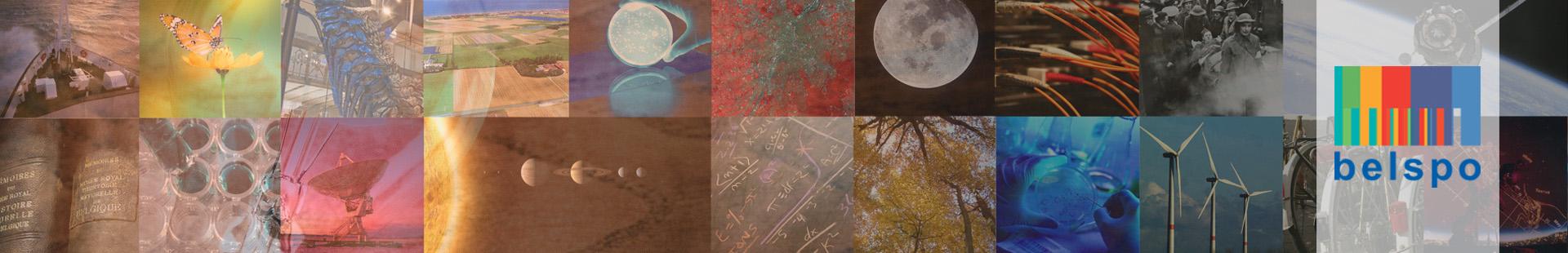
Projet de recherche P6/35 (Action de recherche P6)
DOMAINE
L’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sont des maladies fréquentes des voies aériennes inférieures responsables d’une morbidité et une mortalité significatives à travers la planète et représentant un problème socio-économique grandissant 1,2. Des progrès ont été réalisés au cours des dernières années en ce qui concerne l’identification des mécanismes pathogéniques de ces maladies. Par ailleurs, il devient de plus en plus évident que ces maladies des voies aériennes inférieures sont également associées à des pathologies des voies aériennes supérieures comme la rhinite, la sinusite, et la polypose nasale. Une des découvertes capitales est que les symptômes causés par ces maladies des voies aériennes inférieures et supérieures sont liés à des phénomènes d’inflammation et de remodelage3. Ces découvertes ont mené au concept des « united airways » suggérant une profonde interrelation entre les voies aériennes inférieures et supérieures. Ce concept pourrait par exemple permettre d’expliquer pourquoi jusqu’à 80% des patients souffrant d’asthme allergique souffrent également de rhinite. Des traitements anti-inflammatoires, à base de stéroïdes par exemple, permettent une rémission temporaire des symptômes mais n’amènent pas à une guérison de la maladie. Ainsi, la caractérisation précise au niveau cellulaire et moléculaire des mécanismes immuns impliqués dans ces maladies est une priorité dans la perspective du développement ultérieur de modalités thérapeutiques nouvelles, plus efficaces et durant plus longtemps. De plus, des modifications génétiques au sein des populations ne pouvant expliquer augmentation de l’incidence de ces maladies, nous suggérons que des facteurs environnementaux tels que l’exposition aux allergènes, la pollution et les infections ou leurs interactions réciproques pourraient être impliqués dans la pathogenèse des maladies des voies aériennes supérieures et inférieures.
OBJECTIFS
Les objectifs globaux de ce projet sont décrits par l’acronyme AIREWAY pour effets et interactions de l’allergie, des infections et des expositions respiratoires environnementales sur le développement et la chronicité des maladies des voies aériennes supérieures et inférieures (Effects and interactions of Allergy, Infections and Respiratory Environmental exposures on the development and chronicity of upper and lower airWAY diseases). Par cette approche interuniversitaire, nous proposons de mettre au jour les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent les maladies des voies aériennes supérieures (rhinite, sinusite, polypose nasale) et inférieures (asthme et BPCO). Ces entités pathologiques seront étudiées au moyen de modèles animaux à différentes phases de leur évolution naturelle en ce qui concerne les effets individuels et combinés des allergènes, des infections et des polluants atmosphériques. De plus, les données générées seront validées par des analyses réalisées sur du matériel provenant d’individus sains, utilisés à titre de contrôle, et de populations de patients définies.
MÉTHODOLOGIE
Au cours de ce projet, les mécanismes moléculaires et cellulaires qui sous-tendent l’inflammation chronique impliquée dans ces pathologies de voies aériennes seront étudiés selon plusieurs modalités. Les groupes de recherches sont équipés et qualifiés pour mener à bien les études cellulaires et moléculaires in vitro par exemple sur des cultures épithéliales primaires (d’origine nasale, bronchique, et alvéolaire). Ils ont également une large expertise en ce qui concerne les modèles animaux des pathologies des voies aériennes 4-10. De plus, afin d’assurer la validation clinique des découvertes issues de la recherche fondamentale, les groupes de recherches ont également accès à des échantillons de sérum, sputum, lavages nasaux et alvéolaires de différents groupes de patients (asthme, BPCO, polypose nasale, sinusite, rhinite) 11-13.
BUTS SPÉCIFIQUES
1. Caractérisation des mécanismes de sensibilisation, d’inflammation, et de remodelage survenant au cours des maladies chroniques des voies aériennes supérieures et inférieures.
Les modèles animaux disponibles au sein du consortium pour les diverses pathologies envisagées (asthme, BPCO, rhinite, polypose nasale, sinusite) permettent d’approcher la pathologie présentée par les patients. Le but de l’utilisation de ces modèles animaux est de permettre de réaliser une recherche fondamentale la plus relevante possible au niveau clinique. De ce fait, les modèles animaux nécessitent une caractérisation en profondeur avant que l’effet de facteurs exogènes puisse y être évalué.
Les modèles animaux seront étudiés du point de vue des paramètres physiologiques (fonction pulmonaire et tests d’endurance), de l’inflammation et du remodelage (au niveau cellulaire – cytologie – (immuno)histologie – analyses au FACS) et des interconnexions moléculaires (cytokines, chémokines, facteurs de croissance, enzymes de la matrice extracellulaire). Au niveau cellulaire, nous nous intéresserons particulièrement aux interactions qui existent entre les différents sous-types de cellules T (Th-1, Th-2, NKT, T-reg,…) qui orchestrent les réactions inflammatoires, les cellules présentatrices de l’antigène (cellules dendritiques et macrophages), et l’épithélium. Ces interconnexions moléculaires peuvent être documentées par des expériences in vitro et in vivo pour les différentes entités pathologiques d’intérêt. Ces expériences seront basées sur l’utilisation d’anticorps monoclonaux ciblant certaines molécules d’intérêt (cytokine pro-inflammatoires telles que IL-4, IL-13, IFN-γ versus cytokines immunomodulatrices telles le TGF- ou l’IL-10 ; Toll-like receptor ; et sous-types de cellules immunologiques comme les cellules T-reg et NKT) ainsi que de souris génétiquement modifiées permettant la surexpression ou la suppression de certains gènes.
2. Rôle des agents infectieux, des allergènes, et des polluants environnementaux dans le développement et la pérennisation des maladies respiratoires chroniques.
2.1) Rhinite allergique et asthme : Des données épidémiologiques suggèrent un rôle crucial mais ambigu de l’exposition à des agents microbiens environnementaux dans le développement des maladies des voies aériennes. Bien que l’endotoxine puisse irriter les voies respiratoires (effet pro-inflammatoire), il est bien documenté que l’exposition prolongée protège les voies aériennes contre le développement de maladies allergiques des voies respiratoires supérieures ou inférieures (induction d’une tolérance). Le rôle de l’allergie dans le développement de l’asthme et de la rhinite allergique est bien documenté mais la question fondamentale qui est de savoir pourquoi certains individus atopiques développent de l’hyperréactivité bronchique ou des symptômes d’asthme alors que d’autres restent asymptomatiques est non résolue et doit être élucidée.
2.2) Rhinosinusite chronique, polypose nasale, et BPCO : Des données récentes suggèrent un rôle proéminent de facteurs microbiens comme l’entérotoxine du staphylocoque dans la pathogenèse de la polypose nasale. Si il est évident qu’un lien de causalité existe entre la BPCO et l’exposition à la fumée de tabac, le rôle des infections, de la colonisation bactérienne, et de l’exposition concomitante à des allergènes n’est pas connu.
Au moyen des différents modèles animaux élaborés au cours du déroulement du premier work package et d’expériences in vitro (par exemple des cultures primaires de cellules épithéliales humaines), les effets d’éléments les plus représentatifs des facteurs environnementaux bactériens et viraux (endotoxines, CpGs, polyIC, et entérotoxines) seront évalués. De même, les effets d’allergènes (acariens, pollens, allergènes professionnels) et de polluants environnementaux (fumée de cigarette, diesel, ozone) seront testés séparément ou en combinaison. Plus spécifiquement, l’impact de ces facteurs sur les paramètres physiologiques, inflammatoires et moléculaires définis ci-avant seront mesurés pour chacune des entités pathologiques. Ainsi, les effets de ces interventions seront comparés entre les différentes pathologies de façon à identifier de possibles interactions.
3. Recherche translationnelle : analyses d’échantillons issus de la clinique.
Etant donné que tous les partenaires de cette recherche ont accès à des échantillons cliniques provenant de différentes populations de patients, l’importance des molécules clés jugées intéressantes sera confirmée dans des populations de patients. Comme dans les modèles animaux, le rôle proéminant des cellules dendritiques et des cellules T sera étudié plus avant par l’identification de molécules clés impliquées dans la promotion de certaines populations de cellules T pro-inflammatoires ou dans la suppression de cellules T anti-inflammatoires. Cette approche devrait conduire à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques en vue de réaliser de futurs développements de médicaments.
RÉFÉRENCES
1. Bousquet et al., J Allergy Clin Immunol, 2001, 108, S147-334 / 2. Pauwels et al., Am J Respir Crit Care Med, 2001, 163, 1256-76 / 3. Fokkens et al., Allergy, 2005, 60, 583-601 / 4. Moerloose et al., Am J Respir Crit Care Med, 2005, 172, 168-72 / 5. D’hulst et al., Eur Respir J, 2005, 26, 204-13 / 6. Hellings et al., Eur J Immunol, 2002, 32, 585-94 / 7. Hellings et al., Am J respir cell Mol biol, 2002, 28, 42-50 / 8. Vanoirbeek et al., Toxicol sci, 2003, 76, 338-46 / 9.Vanoirbeeck et al., J Allergy Clin Immunol, 2006, in press / 10. Gueders et al., J Immunol, 2005, 175, 2589-97 / 11. Bachert et al., J Allergy Clin Immunol, 2001, 107, 607-14 / 12. Cataldo et al., Lab Invest, 2004, 84, 418-24 / 13. Demedts et al., Thorax, 2006, 61, 196-201