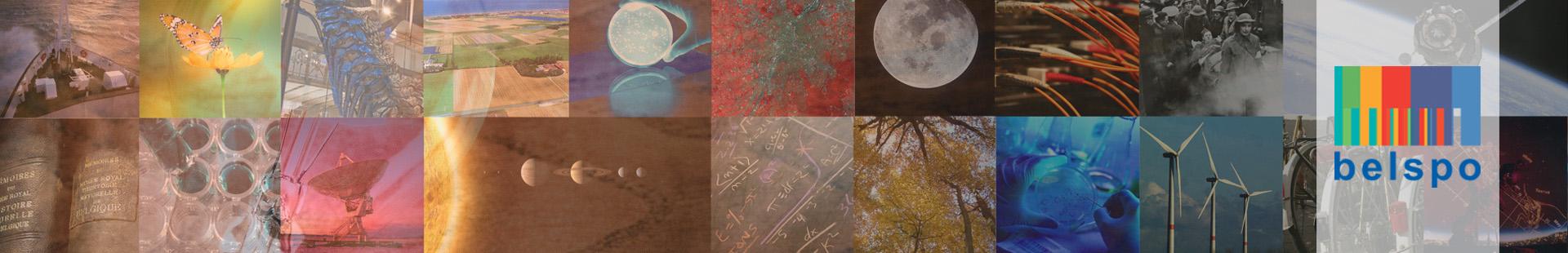
Projet de recherche P7/01 (Action de recherche P7)
Domaine
La notion de genre est la caractéristique la plus ancienne et la plus fondamentale de la littérature. Les genres littéraires sont omniprésents, qu’il s’agisse de distinguer la fiction de la non-fiction, les registres « hauts » ou « bas », l’écriture novatrice de la traditionnelle, ou encore le textuel du performatif. D’innombrables publications ont tenté de conceptualiser, d’étudier et/ou d’utiliser cette notion, à grands renforts de taxinomies. Pour certains, les genres correspondent à autant de manières spécifiques et essentielles de moduler le discours humain. D’autres optent pour une perspective plus fonctionnaliste et relativiste. Plus récemment, la révolution digitale a suscité des changements fondamentaux dans nos manières d’appréhender la littérature. Ces nouveaux supports technologiques ont à leur tour mis l’accent sur l’importance de la médiatisation et de la matérialisation non seulement de l’écriture, mais aussi de la publication et de la réception de la littérature, ce qui induit nécessairement une refondation théorie et pratique de la notion de genre.
Objectifs et questions
Ce projet se situe dans le prolongement des développements les plus récents de la théorie des genres et de la médiologie. Il prend en compte les aspects matériels, culturels, contextuels et historiques de la production littéraire du 19ème, 20ème et 21ème siècle et a pour but de mettre à jour et d’analyser la relation entre la formation générique et les changements apportés par les nouvelles technologies des médias. Parmi les questions posées figurent les suivantes : (1) Quel est l’impact des nouvelles technologies sur l’évolution genres littéraires, en ce y compris sur ce qu’il est convenu d’appeler les « nouveaux » genres ? (2) Quel est le rôle de la littérature en tant qu’agent institutionnalisant de nouveaux supports médiatiques (lesquels sont le plus souvent amenés à survivre s’ils font la preuve qu’ils sont à même de produire du contenu neuf et spécifique) ? (3) Dans quelle mesure cette approche des genres est-elle susceptible de transformer les pratiques d’écriture, de lecture, de publication et de diffusion de la littérature et de modifier des aspects fondamentaux de notre expérience de lecteur/lectrices, voire la notion même de fiction ? (4) Que devient la notion taxinomique de « genre littéraire » et que permet celle, dynamique, de « généricité » au sein de pratiques profondément influencées par les révolutions médiatiques ? (5) Comment peut-on réactiver et repenser la notion traditionnelle de genre non plus comme une ensemble de contraintes formelles et théoriques, mais plutôt comme une pratique culturelle impliquant de nouvelles relations entre la production et la réception textuelles dans un environnement médiatique marqué par une culture de plus en plus hybridisée ?
Dans sa perspective générale, la recherche portera sur les questions suivantes :
1. Mutations génériques: une étude approfondie et systématique des transformations génériques et de leur supports matériels
2. Genre et littérature : une analyse des frontières de la littérature (le documentaire vs. le fictionnel, le fictionnel vs. le non-fictionnel, le réel vs. le faux, le transparent vs. le « médié », l’imprimé vs. le non-imprimé, …) et de leur influence sur les systèmes et théories des genres.
3. Genre et société : une étude approfondie de l’impact culturel et social des transformations génériques (théories de l’auteur, « reader response », communautés littéraires, enseignement de la littérature, registres de valeurs, porosité entre le textuel et le contextuel, entre l’intérieur et l’extérieur de l’œuvre).
Corpus
Le projet repris ci-dessous est le produit d’une collaboration entre les domaines d’expertise respectifs des centres de recherches ici fédérés. Il se propose de répondre aux questions et défis mentionnés plus avant au travers d’une analyse détaillée de genres spécifiques apparus ou ayant subi de profondes transformations au cours du siècle dernier (de la naissance, à la fin du 19ème siècle, des technologies sonores à la révolution digitale apparue dans les années 1980 et qui continue à dominer la scène culturelle actuelle). Les genres et médias sélectionnés sont représentatifs des mutations majeures ayant vu le jour depuis la fin du 19ème siècle, une époque qui introduit de nombreux bouleversements dans les processus de reproduction technologique de la parole et du texte écrit. Les différents sous-projets détaillés plus avant s’attachent à décrire et à théoriser les domaines variés des transformations génériques, en ce y compris les modes de production et de diffusion auditifs et visuels.
Méthodologie
Etant donné la complémentarité des champs d’expertises et compétences des partenaires belges et étrangers, le cadre méthodologique de ce projet sera de nature interdisciplinaire et comprendra deux modes d’approche : des projets menés au sein des centres de recherches, d’une part, et une réflexion commune et concertée sur les médias et la littérature, d’autre part.
Sur le plan épistémologique, un premier axe se concentrera sur différentes études de cas : (1) genres contemporains spécifiques tels que l’interview littéraire, la performance post-dramatique, le discours public littéraire, (2) problématiques générales situées à l’intersection des différents genres étudiés (avatars de la fictionnalité, technique de la boucle en tant qu’alternative aux modèles linéaires de la narration classique, mutations de la notion d’auteur et de la distinction entre auteur et public). Ces genres et ces différentes problématiques ont en commun une structure médiatique complexe et hybride : la littérature telle qu’elle est conçue et pratiquée aujourd’hui n’est en effet plus limitée à la culture textuelle imprimée, mais elle implique au même titre des médias auditifs et audiovisuels dont la complexité entraîne des mutations profondes dans la manière d’appréhender la production, le stockage, l’évaluation et la diffusion de la littérature.
Un second axe de travail proposera une réflexion théorique en vue de redéfinir les genres et médias dans leur portée sociale : de nouvelles formes de production et de réception littéraires engendrent de nouvelles expériences textuelles, de nouvelles communautés de lecteurs/lectrices, ainsi que de nouvelles formes d’institutionnalisation.
L’ensemble de ces débats et considérations contribuera à une meilleure compréhension des transformations de la littérature contemporaine en tant que pratique textuelle et sociale. De la combinaison de ces deux axes doit surgir la méthodologie la plus appropriée pour rencontrer les objectifs de la recherche et répondre aux différentes sous-questions impliquées par la problématique.
Les principales méthodologies mises en œuvre sont les suivantes :
1. Recherche historique et descriptive : la grande majorité des genres étudiés sont sous-représentés dans le domaine des genre studies. Les notions de « posture littéraire » et de « rite » seront cruciales dans la description des échanges entre auteur et lecteur/lectrice.
2. Analyse sémiotique et rhétorique : les concepts-clés sont la reconnaissance et la compétence générique. Cette approche se donne pour but d’encadrer la théorie des genres selon des degrés spécifiques de « généricité », proposant une étude pragmatique (davantage que simplement taxinomique) des genres et systèmes évolutifs envisagés.
3. Intermédialité/performativité : en mettant en évidence les caractéristiques multimodales, contextuelles et dynamiques de la notion de genre, nous privilégierons leur intégration dans le contexte social de la littérature tout en ouvrant la recherche à d’autres champs émergents tels que celui de l’iconographie de l’écrivain.