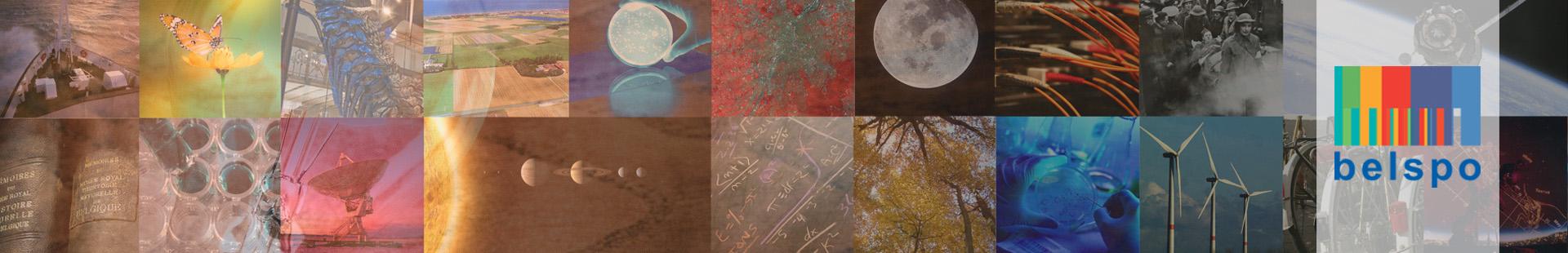
Projet de recherche P7/04 (Action de recherche P7)
Les humains ont un impact énorme sur l'environnement naturel, conduisant à une profonde crise de la biodiversité, qui va des gènes aux écosystèmes (Butchart et al. 2010). Les environnements anthropiques créent aussi de forts régimes de sélection qui peuvent changer les espèces et leur composition génétique (Palumbi 2001; Darimont et al. 2009). Il y a maintenant une théorie unificatrice naissante qui reconnaît que les dynamiques écologiques et évolutives en réponse aux changements environnementaux ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais peuvent fortement interagir, conduisant à des changements importants dans les prédictions des réponses biologiques à des gradients environnementaux (Hairston et al. 2005; Urbain et al. 2008; Pelletier et al. 2009; Schoener 2011; Ellner et al. 2011). Cette nouvelle intégration des dynamiques écologiques et évolutives est inspirée par un nombre croissant d'études démontrant que des réponses évolutives aux changements environnementaux peuvent se produire à la même échelle spatiale et temporelle, et donc avoir un impact direct sur les réponses écologiques (Stockwell et al. 2003). Les dynamiques éco-évolutives sont de plus en plus reconnues comme étant d'une importance clé pour faire des prédictions réalistes des réponses des populations et communautés à des changements anthropiques, notamment les changements climatiques (De Meester et al. 2011; Urban et al. 2011) et le changement d'utilisation des terres (Cheptou et al. 2008). L'amélioration de ces prédictions est essentiele pour concevoir des stratégies de conservation (Lankau et al. 2011). Dans la mesure où ces dynamiques éco-évolutives impactent également le fonctionnement des écosystèmes (Fussman et al. 2007; Matthews et al. 2011), leur examen peut aussi approfondir notre compréhension des changements dans les services des écosystèmes, à savoir les services fournis par les écosystèmes aux sociétés humaines. Précisément parce que la perturbation anthropique crée de nouveaux environnements qui exercent de fortes pressions de sélection, ceux-ci sont également d’excellents systèmes modèles pour étudier comment les organismes s'adaptent à ces défis environnementaux et comment cela influence en retour le fonctionnement des communautés et des écosystèmes. La nécessité d'étudier les dynamiques éco-évolutives dans des environnements anthropiques pour améliorer notre capacité de prédiction peut ainsi être couplée en synergie de leur valeur à nous informer sur la façon dont beaucoup de ces dynamiques éco-évolutives influencent les réponses biologiques.
La variation spatiale joue un rôle clé dans les réponses éco-évolutives aux changements environnementaux. La façon dont les populations locales, les communautés et les écosystèmes réagissent aux changements environnementaux peut dépendre de manière critique de l'interaction entre les réponses locales et régionales (De Meester et al. 2011; Urban et al. 2011). Les populations et les communautés locales peuvent répondre aux changements environnementaux par des changements locaux dans l'abondance relative des génotypes ou des espèces, mais peuvent aussi être fortement influencées par l'arrivée de génotypes ou espèces pré-adaptés du pool régional de génotypes et d’espèces (Urban et al. 2011). La configuration spatiale des parcelles d'habitat peut fortement influencer la manière dont l'environnement façonne les dynamiques éco-évolutives (Kozak et al. 2008). Les taux de dispersion dépendent de la capacité de dispersion des organismes et de leur abondance régionale, tandis que l'identité des immigrés dépend entre autres de la configuration dans l'espace de la qualité des habitats. En outre, les organismes diffèrent largement dans leur mode de reproduction et leur temps de génération, et cela influence fortement la force des réponses locales. En conséquence, l'interaction des réponses locales et régionales dans les dynamiques éco-évolutives devrait varier selon les groupes d'organismes. Ainsi, un cadre prédictif général de l'impact anthropique qui s'appuie sur les dynamiques éco-évolutives nécessite de prendre en compte les variations dans les propriétés des organismes. Dans cette proposition, nous relevons ce défi, réunissant un consortium qui a la capacité de s'attaquer à ce problème à facettes multiples.
Le consortium réunit des équipes d'excellence éprouvée et quelques jeunes équipes prometteuses dans des domaines complémentaires dans la recherche écologique et évolutive (par exemple, Lens et al. 2002; Decaestecker et al. 2007; Van der Gucht et al. 2007; Berwaerts et al. 2008; Bonte et al. 2008; Van Dyck et al. 2009; Hendrickx et al. 2009; Urban & De Meester 2009; Casteleyn et al. 2010; Matthysen et al. 2011). Elles ont une forte expertise dans des approches et des outils complémentaires, y compris les suivis de terrain à grande échelle, l'évolution expérimentale, le génétique des populations et la génomique, la recherche mécanistique sur la dispersion et les traits liés à la fitness (par exemple recherche comportementale, sur les traits d’histoire de vie, et éco-physiologique), et la modélisation. Les différentes équipes ont intégré l'espace dans leurs recherches, soit en se focalisant explicitement sur la dispersion et le fondement mécaniste des événements de dispersion, en quantifiant la configuration spatiale des paysages et à l'aide d'une approche métapopulation ou métacommunauté, soit en simulant la dynamique de métapopulations et métacommunautés par modélisation. Le consortium couvre l'expertise de groupes d'organismes à la fois aquatiques et terrestres, vertébrés (oiseaux et poissons) et invertébrés (zooplancton, arthropodes, escargots,...), plantes et organismes microbiens. Il embrasse donc une grande variété de capacités de dispersion, de modes de reproduction et de temps de génération, essentielle pour parvenir à des conclusions générales. En outre, le consortium couvre des taxons qui interagissent les uns avec les autres, y compris des systèmes hôte-parasite et proie-prédateur, au sein des écosystèmes aquatiques et terrestres et à cheval sur leurs frontières.
Nous adoptons une approche en trois volets:
(1) Recherche collective sur des gradients de perturbation anthropique. Le consortium va investir dans une étude conjointe et hautement intégrée des dynamiques éco-évolutives le long de forts gradients de perturbation anthropique, couvrant plusieurs réplicats le long de gradients d’habitat (semi)-naturel-rural-urbain en Belgique. Dans un effort collectif couvrant hiérarchiquement des échelles spatiales emboîtées et des groupes d'organismes différents, nous documenterons comment les populations et les communautés répondent aux mêmes forts gradients d'impact anthropique. Les gradients d'urbanisation étudiés englobent, entre autres, des changements dans la pollution, la température, la taille des parcelles d'habitat et la connectivité des habitats. L'accent sera mis sur l'analyse conjointe de la structure en métapopulation et métacommunauté pour capter les dynamiques éco-évolutives dans la nature. Les caractéristiques clés de cette recherche seront (a) la caractérisation spatialement explicite et détaillée de la structure du paysage en termes de gradients environnementaux, adaptée aux différents groupes organismes, (b) des analyses génétiques de la structure en métapopulation de taxons focaux, couvrant à la fois des marqueurs neutres et des marqueurs adaptatifs et des traits écologiquement pertinents (c'est à dire impliquant également la génomique des populations et la génétique quantitative), (c) une analyse de la composition locale et régionale en espèces, et (d) les valeurs des traits associés. La combinaison de ces approches permet de lier les dynamiques adaptatives et neutres, tant au niveau de la population et que de celui de la communauté, et ce dans un contexte spatialement explicite. Cette analyse des réponses écologiques et évolutives aux niveaux local et régional pour une gamme de groupes d'organismes offre une opportunité sans précédent pour évaluer comment les environnements anthropiques influencent les communautés biologiques. Dans les cas visés, ceux-ci peuvent être liés à des changements dans les processus des écosystèmes (par exemple la productivité ou les taux de décomposition). Notre approche est beaucoup plus puissante que les traditionnelles méta-analyses pour extraire les réponses différentielles à travers des groupes d'organismes, comme nous travaillons sur les mêmes paramètres du paysage global. Nous allons étudier des gradients d'urbanisation bien caractérisés dans un polygone déterminé par les villes d'Anvers, Gand, Namur et Louvain, qui comprend la ville de Bruxelles.
(2) Recherche mécanistique ciblée sur des questions spécifiques. Nous allons capitaliser sur l'expertise actuelle et les jeux de données des groupes de recherche partenaires pour mener à bien, des expériences mécanistes ciblées qui sont d'une importance cruciale pour informer l'interprétation de nos recherches collectives décrites ci-dessus. Entre autres, nous allons effectuer des recherches mécanistiques sur les décisions de dispersion en milieux (semi-)naturels, des analyses expérimentales sur les réponses écophysiologiques, des expériences d’évolution des essais expérimentale pour étudier le mode et la vitesse d'évolution et les changements associés au fonctionnement de l'écosystème, et des analyses de la dynamique hôte-parasite (avec des oiseaux, papillons, poissons, demoiselles et du zooplancton).
(3) Synthèse à différentes échelles temporelles et spatiales. En plus de la synthèse sur les dynamiques éco-évolutives tirée de nos recherches conjointes décrites ci-dessus, nous allons modéliser ces dynamiques éco-évolutives à travers de larges échelles spatiales et temporelles. Nous allons capitaliser sur nos approches complémentaires de modélisation ainsi que sur notre expertise conjointe sur l'étude des dynamiques écologiques, micro- et macro-évolutives, y compris la radiation adaptative. Notre objectif est de construire des modèles quantitatifs qui englobent les processus évolutifs à différentes échelles temporelles et spatiales dans des contextes qui varient considérablement en matière de connectivité.
Le fruit du PAI proposé sera:
(1) Aperçus dans les réponses des populations et communautés d'un large éventail d'organismes aux même forts gradients anthropiques. La portée de notre recherche fournira des opportunités uniques pour évaluer comment les organismes diffèrent dans leur réponse à l'impact anthropique à différentes échelles spatiales. Cela n'a jamais été réalisé auparavant dans un contexte éco-évolutif, alors même que cela est très pertinent dans ce contexte particulier. Les différences dans les dynamiques locales et régionales, dépendant des capacités de dispersion, de la connectivité, du mode de reproduction et du temps de génération, permettront de déterminer à quel point les dynamiques éco-évolutives vont interagir. Notre étude permettra également d'offrir des occasions uniques d'examiner comment les dynamiques éco-évolutives peuvent avoir un impact sur les interactions entre espèces à travers les niveaux trophiques dans l'espace.
(2) De nouveaux outils et concepts qui répondent à la manière d'intégrer les dynamiques écologiques et évolutives dans un contexte spatial, et permettent ainsi de meilleures prédictions des réactions des populations, des communautés et des écosystèmes aux changements environnementaux. Ceci remplira un besoin urgent compte tenu des défis imposés par l'impact toujours croissant des sociétés humaines sur les systèmes naturels et les risques connexes liés à la détérioration des services fournis par les écosystèmes.
(3) Un solide réseau d'équipes de recherche qui sont à la pointe dans le champ de recherche en plein développement des dynamiques éco-évolutives et une nouvelle génération de jeunes chercheurs bien formés, capable de combiner des approches théoriques et empiriques pour produire des prédictions plus fortes sur les conséquences biologiques de l'impact humain.
(4) Une base de données écologiques et évolutives publique élaborée d'un large groupe d'organismes le long de gradients standardisés de changement anthropique, ce qui peut éclairer l'évaluation des services écosystémiques et les options de gestion.