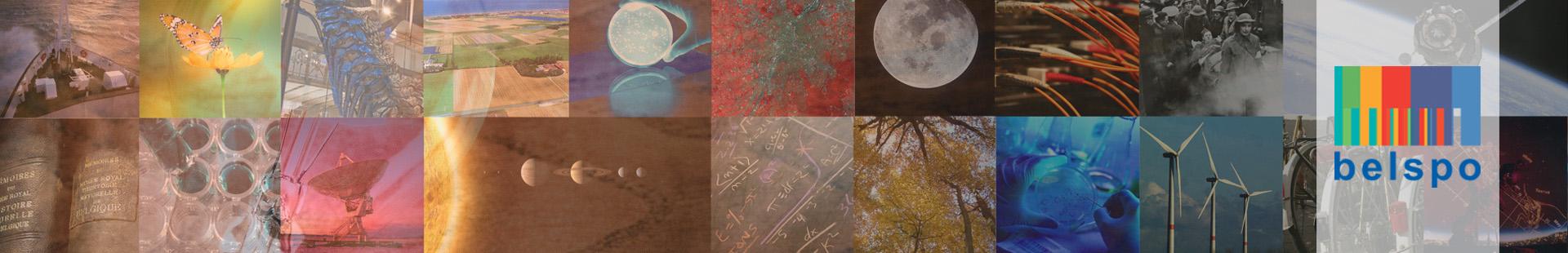
Projet de recherche P7/27 (Action de recherche P7)
Le point de départ de la recherche réside dans le constat que, tant les individus et les groupements qui sont titulaires de droits fondamentaux, que les autorités publiques et les autres entités astreintes aux obligations découlant des normes garantissant lesdits droits, sont confrontés, de manière simultanée, à une multitude de dispositions qui, en la matière, diffèrent quant à leur champ d’application, leur objectif spécifique (focus), leur valeur contraignante et leur provenance institutionnelle. Cette accumulation non-hiérarchisée de dispositifs relatifs aux droits de l’Homme a débouché sur une architecture complexe et dépourvue de coordination, laquelle peut, dans certains cas, créer un obstacle à la protection effective de ces droits. L’objectif central de la recherche qui sera menée au sein du présent réseau consiste en l’étude du Droit des droits de l’Homme comme un ensemble intégré au départ de la perspective de l’utilisateur.
Une première hypothèse de recherche porte sur la pertinence de la mobilisation de concepts et de théories issus de l’anthropologie juridique dans le cadre d’une analyse en profondeur du Droit des droits de l’Homme, analyse que sera menée au départ du point de vue des autorités étatiques et des titulaires de droits. Le concept de pluralisme juridique décrit et analyse la multiplicité des formes de juridicité présentes dans un champ social déterminé. Au départ de cette perspective, la recherche fera une cartographie des recoupements, des conflits et des lacunes que présente l’architecture du Droit des droits de l’Homme, ainsi que des stratégies mises en œuvre par ses utilisateurs aux fins de les circonvenir. En outre, des apports théoriques issus de la littérature dédiée au pluralisme juridique et des théories qui lui sont apparentées – à l’instar de la « théorie du droit en réseau » – alimenteront les propositions normatives du réseau formé par les différents partenaires. Ces approches empiriques seront de surcroît confrontées aux approches normatives juridiques de facture plus traditionnelle, qui opèrent une catégorisation des différents modèles d’intégration juridique, et ce, aux fins d’identifier celui qui, parmi ceux-ci, serait en mesure de réaliser une intégration du Droit des droits de l’Homme.
Une seconde hypothèse de recherche part du constat que l’actuelle absence de coordination entre les différentes sphères du Droit des droits de l’Homme est source d’obstacles qui conduisent à une protection non optimale de ceux-ci, obstacles dont une partie au moins peut être surmontée ou réduite. La recherche identifiera les points de friction qui surgissent dans le cadre d’une approche intégrée des droits de l’Homme, ainsi que les bonnes pratiques d’ores et déjà existantes qui permettent de réduire ces points de friction.
Dans le cadre ci-avant décrit, le réseau de partenaires s’assigne sept objectifs de recherche ambitieux :
1. Développer les cadres théoriques et conceptuels permettant d’appréhender la nature « multi-strates » du Droit des droits de l’Homme
2. Analyser les trajectoires suivies par les utilisateurs au sein de l’architecture complexe du droit des droits de l’Homme
3. Analyser les passerelles, actuelles ou potentielles, reliant différentes strates du Droit des droits de l’Homme
4. Déterminer comment la valeur ajoutée d’une strate bien déterminée du Droit des droits de l’Homme peut être maximisée
5. Définir, au bénéfice des utilisateurs appelés à naviguer au sein des mécanismes internationaux de protection des droits de l’Homme, des conditions optimales d’accès
6. Analyser la tension entre divergence et cohérence au sein du Droit des droits de l’Homme, tant sur le plan
théorique que sur le plan pratique
7. Analyser les interactions qui se jouent entre le Droit des droits de l’Homme et les domaines qui en sont les voisins immédiats : le droit international humanitaire et le droit pénal international
WP. 1. Théorisation de la nature « multi-strates » du Droit des droits de l’Homme
Le WP 1 a pour objet de théoriser et de conceptualiser la nature « multi-strates » du Droit des droits de l’Homme. L’approche bottom-up de l’anthropologie juridique, qui traduit la réalité empirique de la multiplicité des normes et des lieux de protection des droits de l’Homme en termes de pluralisme juridique, sera confrontée à une approche empirique différente – celle du « Droit en réseau » –, ainsi qu’aux approches top-down issues de la philosophie du droit qui sont susceptibles de rendre compte de la même réalité. Tandis que les approches empiriques sont principalement tournées vers l’explication et l’analyse des réalités du terrain, les autres approches précitées sont de nature normative, et destinées à susciter un changement au sein de ces réalités. Par conséquent, les deux types d’approche sont complémentaires. Les concepts et théories issus du pluralisme juridique et du « droit en réseau » aideront à démêler les fils de l’architecture complexe du droit des droits de l’Homme, tandis que les modèles normatifs oeuvreront à une rationalisation du tableau offert en vue d’une intégration du Droit des droits de l’Homme. Des concept papers relatifs à ces différentes approches poseront les jalons utiles pour l’ensemble des work packages formant le présent projet, et assureront la cohésion de l’ensemble de ceux-ci.
WP 2 Les trajectoires suivies par les utilisateurs au sein du Droit des droits de l’Homme
Le WP 2 porte principalement sur une recherche empirique relative à la manière dont les titulaires de droits fondamentaux naviguent au sein de l’architecture complexe du Droit des droits de l’Homme. Il comporte la mise au point d’une méthodologie adéquate, ainsi que le traitement de cinq cas d’étude. Trois d’entre eux envisageront la manière dont des communautés urbaines et rurales précarisées du Sud ont fait usage du Droit des droits de l’Homme dans le but de se prémunir à l’encontre de ce qu’elles percevaient comme des menaces vis-à-vis de leur dignité humaine. Ces études de cas seront conduites en Inde, en RDC et en Chine, en étroite collaboration avec des partenaires institutionnels locaux. Dans le quatrième cas d’étude, le fonctionnement du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sera analysé de la perspective des utilisateurs. Le cinquième cas d’étude envisagera les trajectoires suivies, dans le domaine des droits de l’Homme et dans un contexte migratoire, par les étrangers se trouvant en Europe. Il s’agira de se livrer à une analyse détaillée des parcours juridictionnels suivis par ces titulaires de droits fondamentaux vulnérables, et de la manière dont ils mobilisent, au niveau européen et universel, les éléments fragmentés du Droit des droits de l’Homme et des mécanismes institutionnels affectés à leur surveillance. Cette étude de cas permettra tout à la fois l’identification de bonnes pratiques, et l’analyse des obstacles que de tels acteurs rencontrent dans leur quête de justice au sein du labyrinthe des droits de l’Homme.
WP3. Les passerelles reliant différentes strates du Droit des droits de l’Homme
Le WP3 explorera les différentes voies permettant d’envisager une vision intégrée des droits de l’Homme, et ce, en tant qu’elles constituent tout à la fois le projet d’une évolution normative future et l’objet d’une pratique contentieuse actuelle. Un premier axe de recherche, centré sur le contentieux porté devant la Cour européenne des droits de l’Homme, y examinera les procédés de référence à des « sources externes » et de « références croisées », lesquels aboutissent de facto à jeter des ponts entre les différentes strates du Droit des droits de l’Homme. Ces procédés suscitent cependant d’importantes difficultés en termes de légitimité, lesquelles requièrent une analyse en profondeur. Par ailleurs, des questions cruciales relatives à la « méthodologie » de ces procédés seront abordées, telle la question de la transparence de leur utilisation, nécessaire en vue de dissiper tout soupçon d’arbitraire. Le second axe de recherche sera centré sur les résultats obtenus ou escomptables grâce aux ponts ainsi jetés. Leur effet intégrateur est-il à ce point performant qu’il conduise à la construction d’un corpus juris fonctionnellement équivalent à la promulgation d’un instrument de hard law en bonne et due forme ? Cette question sera traitée au travers d’un étude de cas portant sur les droits catégoriels des personnes âgées.
WP 4. La maximisation de la valeur ajoutée des textes ou mécanismes de protection des droits de l’Homme : A-t-on besoin d’un catalogue constitutionnel de droits et libertés ?
Le WP 4 sera centré sur le statut et les fonctions d’une source formelle particulière au sein du système « multi¬strates » de protection des droits de l’Homme, en l’occurrence, les catalogues constitutionnels qui sont dédiés à cet objet. En replaçant cette source spécifique dans le contexte du Droit des droits de l’Homme considéré globalement, émergera la question de savoir comment sa valeur ajoutée peut être, du point de vue de ses utilisateurs, optimisée. Depuis quelques années en effet, la promotion d’une approche intégrée du Droit « fragmenté » des droits de l’Homme, a notamment pris la forme d’une réflexion sur la modernisation du catalogue constitutionnel de protection des droits et libertés. L’idée serait de faire de ce catalogue un « interface », ou encore une « synthèse » intégrant et ordonnant les apports issus des différentes strates du Droit des droits de l’Homme. Il s’agira
d’examiner de manière critique la faisabilité d’une telle entreprise, en mobilisant les ressources de la théorie du droit, du droit comparé, de la science politique et de la sociologie du droit.
WP5. L’optimisation de l’accès aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’Homme
Le WP 5 envisagera les dimensions procédurales de l’intégration du Droit des droits de l’Homme, en se centrant sur les mécanismes de plainte internationaux. Alors que des organes de surveillance tels la Cour européenne des droits de l’Homme ou encore, la Commission et la Cour américaines des droits de l’Homme, font face à un nombre croissant voire gigantesque de requêtes, certains requérants individuels, et singulièrement ceux qui sont issus de groupes vulnérables, continuent à rencontrer des obstacles de fait ou de droit qui les empêchent de porter au contentieux, de manière effective, les litiges relatifs à la violation supposée de leurs droits fondamentaux. La recherche menée aboutira à la formulation de modèles clairs et scientifiquement étayés destinés à concilier, d’une part, le souci d’accès optimal aux mécanismes contentieux, et, d’autre part, les impératifs de l’efficacité procédurale et de la gestion efficiente du flux des affaires introduites. Une attention particulière sera portée à la question de savoir dans quelle mesure les solutions et stratégies développées dans le cadre d’un système régional (voire au-delà des systèmes régionaux) peuvent bénéficier à un autre système.
WP.6 Cohérences et divergences au sein du Droit des droits de l’Homme
Le WP 6 envisagera les aspects, positifs ou non, que peut présenter un Droit des droits de l’Homme en tout ou partie non-intégré. En effet, se pose de manière centrale la question de savoir dans quelle mesure le pluralisme en matière de droits de l’Homme ménage la possibilité de variations autour d’un même thème, singulièrement dans la formulation et l’interprétation de normes identiques. La recherche menée définira un cadre de référence formé de lignes directrices opérant la démarcation des degrés admissibles de divergence au sein de situations spécifiques déterminées. Par suite, il s’agira de fournir un inventaire des techniques juridiques, existantes ou en devenir, qui permettent de ménager, tout en la gardant sous contrôle, la divergence observée dans la formulation et l’interprétation des droits de l’Homme. Ce thème sera approfondi au travers de deux études de cas de large amplitude. Le premier concerne le potentiel que représente, pour la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), l’outil de la « marge nationale d’appréciation » développé par la Cour de Strasbourg (CEDH). La seconde étude de cas analyse les différentes manières dont les divers systèmes de protection appréhendent la question des droits des peuples indigènes à la protection de leurs terres et ressources, compte tenu spécifiquement de la résistance dont l’Europe fait montre à l’égard de l’idée même de droits collectifs.
WP 7 La clarification de la zone grise séparant les violations des droits de l’Homme commises dans l’ordre interne et les crimes contre l’Humanité
Le WP 7 élargira le questionnement central de la présente recherche à la thématique des frontières floues du Droit des droits de l’Homme. Les vocations respectives du Droit international des droits de l’Homme (DIDH), du Droit international humanitaire (DIH) et du Droit pénal international (DPI) s’enracinent dans un idéal commun : le respect dû à l’autonomie et à l’intégrité des individus, et la protection de ceux-ci contre les abus de l’autorité étatique. Il s’agira d’envisager le potentiel d’intégration de ces différents flux juridiques, en concentrant l’attention sur le concept central de crime contre l’Humanité. Seront identifiés les différents points de friction révélés par l’expérience d’une intégration entre le DIDH et le DPI, consistant à utiliser le second comme mécanisme de sanction des violations du premier dans la problématique des crimes contre l’Humanité. Les désaccords observés quant à la définition exacte de ces derniers ont conduit à une protection non-optimale des droits de l’Homme. La recherche menée mettra à l’épreuve la validité de l’argument selon lequel le développement progressif du DPI et du Droit des crimes contre l’Humanité aurait été stoppé par l’influence du DIDH, compte tenu du caractère « stato-centré » de ce dernier.