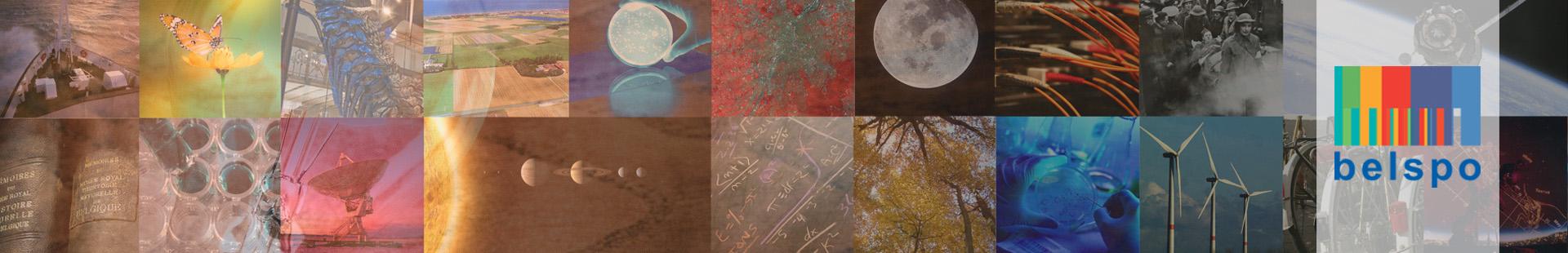
Projet de recherche P7/32 (Action de recherche P7)
La réponse inflammatoire est cruciale dans la défense de l’hôte et également dans la réparation cellulaire.
L’inflammation est certes bénéfique mais peut devenir problématique lorsqu’elle n’est plus correctement
régulée. En conséquence, un grand nombre de pathologies inflammatoires, qu’elles soient aiguës ou
chroniques, résulte de la dérégulation de points de contrôle importants. Ces patients souffrant de damages
tissulaires résultant de mort cellulaire, de réorganisation des matrices extracellulaires ou de production
excessives de cytokines proinflammatoires. De nombreux signaux inflammatoires déclenchent des voies de
signalisation qui convergent vers le facteur transcriptionnel NF-B dont l’activation assure l’expression de
gènes impliqués dans la réponse inflammatoire et dans la survie cellulaire. Par conséquent, il est important
de comprendre de façon exhaustive comment ces voies de signalisation activent ce facteur transcriptionnel.
La mort cellulaire et l’inflammation sont intimement liées. Une mort cellulaire excessive, qu’il s’agisse
d’apoptose ou de nécrose, peut conduire à une destruction cellulaire, ce qui entraîne une inflammation et/ou
une dégénération tandis que la mort cellulaire par nécroptose (une forme régulée de mort cellulaire par
nécrose), peut être à la base de plusieurs réactions inflammatoires. De plus, de nombreuses voies
convergent vers la réaction au stress du RE, à la réponse de la protéine dépliée («UPR») et vers
l’autophagie, un processus catabolique impliquant la dégradation de protéines via le lysosome. L’autophagie
a été identifiée comme un processus important pour la modulation de l’inflammation et de la mort cellulaire.
NF-B controle l’autophagie qui peut alors assurer la survie des cellules soumises à un stress. Les
interactions entre l’inflammation et la mort cellulaire contribuent de manière significative à la carcinogenèse
en permettant aux mécanismes de survie d’être activés. A ce titre, des cellules mourantes génèrent et
libèrent des molécules de danger capables de provoquer des dommages cellulaires («DAMPs) qui activent
ou inhibent le système immunitaire et qui peuvent mettre en place des réponses anti-tumorales pendant les
chimiothérapies (mort cellulaire immunogène). De plus, des modifications de l’homéostasie de la production
des acides gras sont fréquemment requises pour la résistance à la mort cellulaire. Enfin, la régulation de
cette mort et de l’inflammation est cruciale dans la réponse de tout organisme aux agents infectieux. Les
mécanismes moléculaires qui régissent ces interactions entre ces processus cellulaires ne sont pas
encore totalement élucidés. L’identification et la caractérisation de ces événements au niveau d’un
organisme entier reste un défi majeur tant pour la compréhension de l’inflammation que pour celle du
cancer. Nous souhaitons apporter de nouvelles évidences mécanistiques au niveau moléculaire pour
solidifier les liens fonctionnels entre l’inflammation et la mort cellulaire afin de proposer puis d’initier de
nouvelles approches thérapeutiques.
Les buts de notre réseau sont (1) d’identifier les mécanismes moléculaires et les voies de
signalisation qui contrôlent la mort cellulaire et l’inflammation, (2) d’établir la relevance de ces mécanismes
dans des modèles murins de pathologies inflammatoires infectieuses ou stériles ou dans des modèles de
cancérologie expérimentale disponibles dans nos laboratoires, (3) de traduire en ces connaissances relevant
de la recherche fondamentale en nouvelles applications thérapeutiques. Notre réseau, constitué de 4
partenaires belges et de 2 internationaux, comprend 16 groupes de recherche (7 de l’Ugent, 2 de la
K.U.Leuven, 3 de l’Ulg, 2 de l’WIV-ISP, S. Fulda et A. Samali) dont l’expertise est internationalement
reconnue dans leur domaine d’expertise et qui se représentent 3 universités belges (Ugent, K.U.Leuven et
Ulg), un institut fédéral (WIV-ISP, Bruxelles) et deux institutions internationales (Université de Francfort et
Université de Galway). Ce réseau très équilibré et ses liens avec d’autres réseaux (MRP, projets européens,
Methusalem, Hercules, FWO, FNRS, IWT-SBO, WELBIO) de même qu’avec d’autres experts étrangers
permettent d’acquérir une masse critique de chercheurs et une plus-value qui est bien supérieure à
celle qui résulterait du travail d’une seule équipe. Dès lors, les réunions scientifiques organisées dans le
cadre de ce consortium vont s’organiser sous forme de conférences à petite échelle, de façon
pluridisciplinaire sur les thématiques qui relèvent de la mort cellulaire et de l’inflammation. Ces réunions se
mettront en place dès le début de cette nouvelle phase.
Premier objectif: Identification des mécanismes moléculaires et des voies de signalisation qui
contrôlent la mort cellulaire et l’inflammation.
NF-B régule l’expression de nombreux gènes codant pour des protéines impliquées dans
l’inflammation et la survie cellulaire. Une dérégulation de l’activité de NF-B contribue de façon
prépondérante au développement des pathologies inflammatoires et cancéreuses. Les voies de signalisation
dites classiques ou alternatives qui conduisent à l’activation de ce facteur transcriptionnel sont déclenchées
par des cytokines pro-inflammatoires (TNF, IL-1, IL-33), des molécules endogènes ou microbiennes
détectées par les récepteurs de la famille des TLRs, RIG-1 ou Nod2 seront étudiées. Les voies déclenchées
via les récepteurs aux antigènes (TcR, BcR), les récepteurs à l’ATP ou par des protéines chimériques
(IAP2/MAL1) ou suite à un stress cellulaire (stress lié au réticulum endoplasmique, stress photo-oxydant)
seront investigués également. Certains partenaires au sein du consortium étudieront les voies de
signalisation résultant d’un stress du réticulum endoplasmique et leur connections avec les voies de
signalisation conduisant à l’activation de NF-B. Cette approche expérimentale se concentrera sur des
molécules essentielles telles que des enzymes intervenant dans la régulation de la polyubiquitination des
protéines (A20, IAPs, CYLD), des protéases (MALT1, caspases), des enzymes modifiant les lipides et des
kinases (NIK, TBK1, IKK, ATM, RIPK1-4, PERK) qui sont toutes connues pour être dérégulées dans les
pathologies inflammatoires et/ou cancéreuses. De nouvelles interactions protéine-protéine impliquant ces
protéines étudiées seront mises à jour et caractérisées au sein de notre réseau à l’aide des approches
protéomiques et génomiques les plus récentes. Nous souhaitons par ailleurs intégrer ces découvertes dans
des réseaux bioinformatiques afin d’apporter une vue globale de la fonction de ces protéine et de leur
capacité à établir des interactions avec d’autres molécules de signalisation impliqués directement ou pas
dans des pathologies. A titre d’exemple, les kinases RIPK1 et RIPK3 qui s’avèrent jouer un rôle important
dans la formation du nécrosome dont l’activation conduit à la nécroptose interviennent également dans le
métabolisme bioénergétique. Comment un stress du réticulum endoplasmique ou l’autophagie contrôlent-ils
l’inflammation et la mort cellulaire, comment ceci conduit à génération de DAMPs (protéines membranaires
ou intracellulaires, lipides, cytokines ou ATP, …) sont des questions qui seront abordées expérimentalement
dans le cadre de notre réseau. L’étude des voies de signalisation induites par la nécroptose et le stress du
réticulum endoplasmique constitue une thématique importante de notre réseau. Les DAMPs peuvent être
exploités afin d’induire ou de limiter des réactions inflammatoires. Leur étude contribuera à une meilleure
compréhension de la mort cellulaire immunogène observée lors des thérapies anti-cancéreuses. Les
cytokines IL-1et IL-18 sont des médiateurs inflammatoires dont l’expression est régulée au niveau
transcriptionnel par NF-B mais également au niveau post-traductionnel par la caspase-1 dont l’activation
fait intervenir l’inflammasome. Nous étudierons les interconnections entre NF-B et l’inflammasome NLRP3
de même que son implication dans le diabète des patients obèses. Sa régulation par les acides gras
insaturés sera également étudiée.
Deuxième objectif: Développement et étude de modèles murins d’inflammation infectieuse ou stérile,
de modèles cancéreux afin de préciser les fonctions biologiques des gènes étudiés à l’échelle d’un
organisme entier.
Afin d’étudier la relevance de nos découvertes obtenues à l’échelle moléculaire, de nouveaux
modèles de gain ou de perte de fonction (conditionnelle ou totale) seront développés (par exemple pour les
gènes A20, CYLD, optineurine, NIK, IKK, RIPK1, RIPK3, RIPK4, …) et croisées avec des modèles de
pathologies pour lesquels l’expertise requise est présente dans notre consortium (par exemple le modèle de
choc septique, CLP, le modèle de diabète, d’asthme, d’inflammation cutanée, hépatique ou intestinale, les
modèles tumoraux, de sclérose en plaque ou de neurodégénération. Les kinases RIPK1 et RIPK3, en
intervenant dans la nécroptose, jouent un rôle majeur dans les réactions inflammatoires telles que le
syndrome d’inflammation systémique (SIRS) ou l’inflammation de l’intestin. La nécroptose pourrait dès lors
constituer un processus pouvant être ciblé par de nouvelles approches thérapeutiques. Nous étudierons
également la contribution de certaines caspases telles que les caspases-1, -3 et -7 dans la mort par
apoptose dans nos modèles inflammatoires.
Troisième objectif: Recherche translationnelle pour identifier de nouvelles approches thérapeutiques
anti-inflammatoires ou anti-cancéreuses.
Certains membres de notre réseau sont également impliqués dans le développement de nouvelles
thérapies qui interfèrent avec des médiateurs majeurs de l’inflammation (TNF, IL-33, MMPs) ou qui
préviennent l’inactivation du récepteur aux glucocorticoïdes. Des membres de notre réseau ont récemment
découvert que la nécroptose faisant intervenir les kinases RIPK1 et RIPK3 constitue une nouvelle stratégie
pour déclencher la mort cellulaire dans des cellules capables de résister à l’apoptose telles que des cellules
tumorales provenant de patients cancéreux. Ces résultats soulignent l’intérêt de considérer la nécroptose
comme une nouvelle cible thérapeutique pour contourner la résistance acquise des cellules cancéreuses.
Grâce à l’identification de nouveaux DAMPs (premier objectif), nous développerons également des essais
pré-cliniques dans des modèles murins destiner à promouvoir ou à inhiber la fonction de ces DAMPs
(thérapie anti-cancéreuse ou anti-inflammatoire, respectivement).