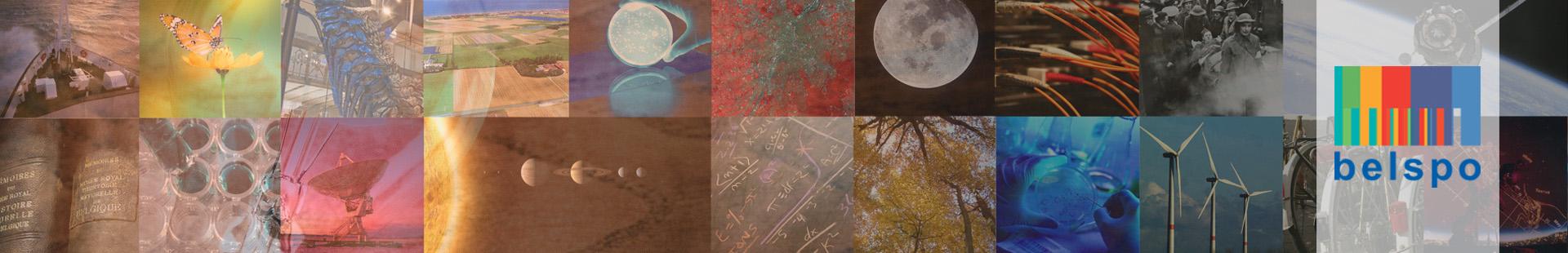
Projet de recherche P7/37 (Action de recherche P7)
Comprendre les interactions fondamentales : collaboration entre équipes de recherche de théoriciens et équipes d’expérimentateurs
Les interactions fondamentales comprennent les forces électrofaibles, l'interaction forte, et la gravité (et leurs extensions éventuelles). Leur étude vise à élucider les mécanismes de la Nature à leur niveau le plus intime, et devrait également mener à une compréhension de notre Univers et de son évolution, grâce à un travail à la pointe des connaissances actuelles. Cette quête implique les outils expérimentaux les plus puissants (notamment le grand collisionneur de hadrons du CERN) et les moyens d'observation les plus raffinés (en particulier dans les recherches sur la matière noire et sur les astro- et cosmo-particules).
Les phases précédentes du programme PAI, impliquant la plupart des équipes actuelles (PAIV/27 et VI/11), ont établi une collaboration étroite entre théoriciens et expérimentateurs. Cela a été reconnu avec enthousiasme par une évaluation « ex post » très approfondie. Les cinq prochaines années verront des développements cruciaux avec les résultats escomptés suivants :
- Le LHC à Genève a atteint sa « vitesse de croisière », et devrait fournir les premières réponses concernant le mode de réalisation du mécanisme de Brout-Englert-Higgs (voir ci-dessous), déjà probablement sur la base des données recueillies d’ici fin 2012, avant un arrêt décisif pour améliorer les capacités de l'accélérateur. En particulier, cet outil puissant et polyvalent permettra de sonder la physique au-delà du Modèle Standard, de chercher les candidats à la matière noire, et de sonder des dimensions supplémentaires si elles sont suffisamment grandes…
- Partout dans le monde, des expériences portent sur la nature des masses et du mélange des neutrinos d'une part, sur les détections directe et indirecte de la matière noire de l'autre, avec une sensibilité considérablement accrue. Même si la définition d’un calendrier semble difficile, nous sommes définitivement entrés dans une ère passionnante.
- La cosmologie observationnelle (héritage de G. Lemaître), qui inclut les résultats attendus pour bientôt des satellites Planck et des satellites gamma, mais aussi ceux des détecteurs de rayons cosmiques et de neutrinos, comme Auger, TelescopeArray ainsi qu’IceCube et ses extensions, teste les prédictions détaillées de modèles astrophysiques et cosmologiques avec une sensibilité sans cesse accrue. La matière noire, l’énergie noire, et l'origine des rayons cosmiques de très haute énergie sont quelques-uns des principaux mystères à élucider.
Cette période est également cruciale pour le fonctionnement des équipes de recherche belges :
- Une nouvelle génération de physiciens, éduqués dans les périodes des précédents PAI, joue un rôle de premier plan non seulement dans la recherche, mais aussi dans la planification des collaborations et de la stratégie de recherche pour l'avenir : la plupart de nos nœuds ont de nouveaux gestionnaires, et deux de ces noeuds ont été reconfigurés afin de souligner les interactions élargies entre théorie, phénoménologie et expérimentation dans le cadre de la physique du LHC. Ces nouveaux gestionnaires ne viennent pas au dépourvu, et ont déjà marqué les précédents PAI, notamment par leur contribution au groupe de travail « expériences futures » du PAI VI, qui a proposé une feuille de route pour les projets expérimentaux des équipes belges - une tâche essentielle qui sera poursuivie avec énergie.
- En parallèle avec une recherche de pointe, la nécessité d'une collaboration au niveau de la formation s’est fait ressentir et a conduit à une série d'initiatives dans les réseaux précédents : non seulement une liste impressionnante de cours de Master et de Doctorat (enseignés en anglais dans les différentes institutions, ce qui conduit à l'échange d'étudiants, déjà considérable au niveau Master), mais aussi des écoles d'été plus traditionnelles, et des congrès (comme la série Moriond, qui accorde une attention particulière aux jeunes scientifiques). Le nouveau réseau permettra de systématiser ces outils de formation, et d’en faire la publicité.
- La structure éprouvée d'un «Conseil du PAI », responsable de toutes les embauches (au niveau doctoral ou postdoctoral) permet une plus grande visibilité, une bonne coordination, et assure des normes de recrutement très élevées. Elle a été notée très positivement par l'évaluation ex post, et elle va bien sûr continuer à jouer son rôle. Les coordonnateurs des groupes de travail, qui sont apparus spontanément dans le réseau précédent, devraient désormais jouer un rôle plus important.
Dans la description suivante, nous évoquons à la fois la complémentarité de nos axes de recherche, et les questions de physique les plus importantes.
- Les groupes de théorie cherchent à établir des modèles d'unification qui englobent les interactions connues. Deux méthodes, « déductive » et « inductive », sont utilisées. L'approche « déductive », tout à fait typique de la physique mathématique, repose sur la supposition de symétries à partir desquelles on peut construire une structure convaincante (et souvent élégante) ab initio, en utilisant les contraintes venant de la cohérence mathématique, en particulier l'absence de divergences incontrôlables. À partir de ces structures très générales (par exemple, la théorie des cordes, la supergravité, ou des variantes de la relativité générale), les observables physiques doivent ensuite être déduites (souvent avec des hypothèses nouvelles, par exemple, la structure topologique des dimensions supplémentaires). En particulier, nous sommes confrontés au problème de la description de la gravité et des autres forces fondamentales dans un même cadre quantique.
L’approche « inductive » part des faits expérimentaux marquants, tels que la forte suppression de certains processus, la masse et le mélange des particules ou les contraintes sur la matière noire, et tente de construire des modèles d'unification (généralement moins ambitieux que les précédents) . Ceci inclut diverses extensions possibles du Modèle Standard des interactions forte et électrofaible.
- Dans les deux cas, les modèles ne peuvent être validés que par la prédiction et l’observation de toutes leurs conséquences expérimentales ou observationnelles.
- Une des tâches principales du LHC sera d'élucider de quelle manière le mécanisme de Brout-Englert-Higgs (qui provient de nos groupes et qui est nécessaire pour unifier les interactions électrofaibles) est réalisé : allons-nous trouver un scalaire fondamental unique, une structure plus complexe impliquant de la matière noire, des états liés ou une nouvelle interaction forte?
Dans ces recherches, il faut maîtriser les interactions fortes : elles sont à la fois un sujet d'étude, dans lequel les approches théoriques et expérimentales se complètent constamment, et un bruit de fond qui doit être évalué de façon très précise pour en extraire les processus rares que l’on cherche.
- Les groupes expérimentaux travaillent dans de grandes collaborations internationales, en utilisant les accélérateurs les plus puissants et les détecteurs les plus modernes pour recueillir les données nécessaires aux tests de telles théories ou pour forcer une nouvelle approche. Au LHC, les équipes belges ont concentré leurs efforts sur le détecteur CMS, où de nombreux canaux d'analyse sont explorés (nature des mécanismes de rupture de symétrie, physique des saveurs avec des quarks top, recherche de particules au-delà du Modèle Standard, de grandes dimensions supplémentaires, etc.). La physique de la saveur dans l'expérience NA62 (dans laquelle notre participation découle du précédent PAI) apporte également des contraintes fortes sur les modèles de « nouvelle physique ». D’autres domaines d'expérimentation en cours impliquent la physique du neutrino (l'expérience OPERA, près de Rome, détecte les neutrinos produits au CERN), l’astrophysique des neutrinos (IceCube est un détecteur de 1 km3 dans la glace de l'Antarctique, et cherche également des signaux indirects provenant de la matière noire), les rayons cosmiques de haute énergie (Telescope Array, IceCube et ses extensions). Alors que l’aspect « matériel » des activités expérimentales est couvert par d'autres sources de financement (IISN, FWO), un effort considérable dans l'interprétation des données doit être poursuivi.
- Au-delà de ces expériences qui ont une implication directe dans la prise de données, nous utilisons également les données d'un certain nombre d'autres tests (recherches directe ou indirecte de matière noire, expériences sur satellites), et, en particulier, nous participons à l'analyse des données de Planck, qui scrute pour l’instant le rayonnement fossile de l’Univers.
Notre but ultime est d'améliorer notre compréhension des interactions fondamentales ; pour cela, nous devons :
• développer le potentiel de chaque groupe par des moyens supplémentaires (principalement l'échange international de postdocs);
• resserrer la collaboration des groupes et les liens entre leurs activités ;
• former un nombre important de jeunes scientifiques. L'excellence dans leur propre domaine et une solide formation dans les domaines connexes, apportées toutes deux par ce réseau, leur permettra contribuer significativement à notre compréhension des lois physiques.
Nos partenaires étrangers sont choisis pour soutenir et renforcer le travail de notre consortium, tant par leur excellence en recherche et que par leur contribution à l'organisation commune de réunions de haut niveau international.