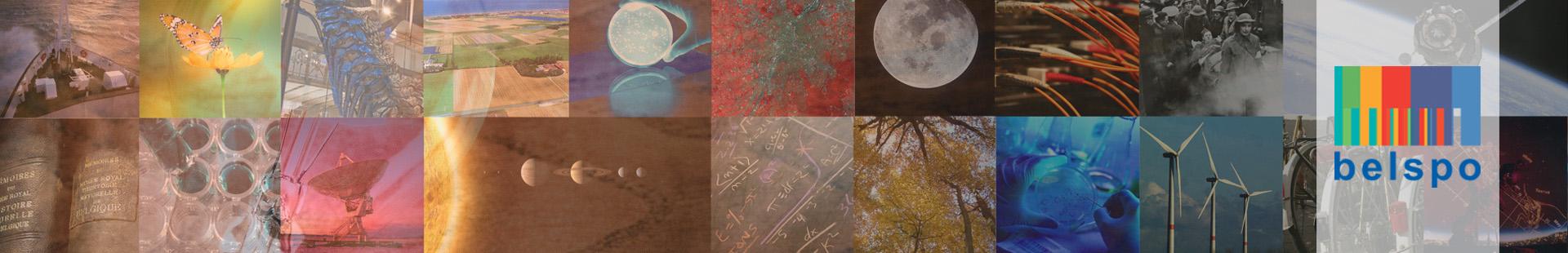
Projet de recherche P7/39 (Action de recherche P7)
L’objectif principal de notre projet est d’appréhender les mécanismes qui régulent la différenciation des lymphocytes T et l’acquisition de leurs fonctions effectrices en réponse à une stimulation antigénique, notamment dans le cadre de programmes d’immunothérapie du cancer. L’identification, par une des équipes membres de notre consortium, d’antigènes tumoraux a ouvert la voie à de nouvelles approches thérapeutiques du cancer basées sur le principe de la vaccination. Pour être efficaces, ces nouveaux vaccins doivent (i) induire la différenciation in vivo de cellules T spécifiques d’antigènes tumoraux exerçant une fonction effectrice adéquate (cytotoxique / inflammatoire) et (ii) permettre à ces cellules d’échapper aux mécanismes suppresseurs qui inhibent l’immunothérapie.
Cet objectif à long terme requiert une meilleure connaissance de la linguistique moléculaire qui contrôle les interactions entre cellules du système immunitaire et en particulier: (i) l’identification des molécules costimulatrices et cytokines qui constituent des signaux de communication entre lymphocytes; (ii) une meilleure connaissance des cascades de signalisation intracellulaires initiées par ces médiateurs; et enfin (iii) l’identification des mécanismes de suppression « cellulaires autonomes » (défauts cellulaires intrinsèques) et « infectieux » (imposés par un autre type cellulaire) qui limitent le développement des réponses immunes in vivo. Ce projet, qui réunit 9 équipes de recherche avec des compétences à la fois similaires et complémentaires dans le domaine de l’immunologie clinique et fondamentale, sera organisé en 5 sous-projets (ou workpackages, WP), brièvement résumés ci-dessous.
WP1. Différenciation et fonction des sous-population de lymphocytes T auxiliaires.
L’objectif principal de ce WP sera de caractériser une série de nouvelles sous-populations de lymphocytes T. Des sous-populations fonctionnellement distinctes de cellules auxiliaires capables de réguler la réponse humorale ont été décrites récemment. En effet, les cellules de type Th2 et TFH (cellules T folliculaires) sont toutes deux susceptibles d’induire la production d’anticorps de haute affinité par les lymphocytes B. Notre projet visera à étudier si ces lymphocytes représentent des sous-populations distinctes, ou si les cellules TFH représentent un état de différenciation transitoire de cellules engagées dans la voie de différentiation « Th2 ». De même, la nature et la fonction exacte des cellules produisant l’IL-9 (une cytokine originellement décrite comme spécifique de la voie de différenciation Th2) ne sont pas connues, une question qui sera abordée grâce aux outils moléculaires (souris KO et/ou transgéniques) dont nous disposons au sein de notre consortium. Enfin, la source cellulaire (lymphocytes T ou « innés »), le rôle fonctionnel et la régulation de l’expression des cytokines de la famille Th17 (en particulier l’IL-17 et l’IL-22) seront évalués chez la souris via le développement de modèle animaux inflammatoires et d’outils adéquats (souris KO, anticorps monoclonaux bloquants,…).
WP2. Les lymphocytes T régulateurs et la suppression des réponses immunes.
L’objectif de ce WP est d’entreprendre une étude détaillée des mécanismes moléculaires sous-tendant la fonction suppressive des cellules T régulatrices (Tregs), à la fois chez l’homme et l’animal. Le projet s’articule autour de trois médiateurs distincts (TGF, CD27 et adénosine) susceptibles de contrôler négativement le développement d’une réponse immune. Nous caractériserons le rôle de nouvelles sous-populations de lymphocytes Tregs, afin de comprendre si ces cellules représentent des états d’activation alternatifs ou des cellules à différenciation terminale distincte. Ces cellules semblent particulièrement aptes à diminuer le développement de réponses immunes fonctionnellement distinctes, mais leur mode d’action (expression sélective de molécules suppressives ou propriétés migratoires distinctes) reste à déterminer. Enfin, la relevance clinique de ces modèles animaux sera évaluée par l’étude de cellules Tregs d’origine humaine, issues de patients atteints de tumeurs ou souffrant de maladies autoimmunes.
WP3. L’inactivation fonctionnelle des lymphocytes T.
La stimulation chronique des lymphocytes T conduit souvent à une forme d’inactivation fonctionnelle appelée « adaptation ». Cet état de « non-réponse » représente un obstacle potentiel à la vaccination thérapeutique, notamment lors d’infections virales chroniques ou chez des patients porteurs de tumeurs. L’étude d’un modèle animal de cellules « adaptées » nous a déjà permis d’établir leur profil transcriptionnel, qui se caractérise notamment par l’expression de nombreux récepteurs à signalisation « négative ». De manière intéressante, un profil similaire a été identifié dans des lymphocytes T humains issus d’enfants infectés « in utero » par le cytomégalovirus (HCMV) et caractérisés par la perte d’expression de la molécule CD28. Ces études seront étendues à une population de lymphocytes T CD28-négatifs, récemment identifiés chez des patients atteints de sclérose en plaque. Enfin, des cellules T présentant une inactivation fonctionnelle ont aussi été identifiées au sein de tumeurs humaines, suggérant l’existence de mécanismes d’adaptation communs entre l’homme et l’animal. Un des objectifs de notre consortium est d’identifier de nouvelles pistes thérapeutiques visant à restaurer l’activité anti-tumorale ou anti-virale de ces lymphocytes « adaptés ».
WP4. Régulation de l’activité des lymphocytes T par la réponse immune innée.
Les cellules dendritiques et les macrophages jouent un rôle essentiel dans la régulation d’une réponse immune à l’interface entre immunités innée et adaptative. Ces cellules constituent une population hétérogène, dont les propriétés fonctionnelles restent encore mal caractérisées. L’objectif de ce WP est d’identifier les mécanismes qui confèrent aux différentes sous-populations de cellules présentatrices d’antigène (APCs) la capacité d’induire la différenciation de lymphocytes T naïfs en cellules effectrices distinctes (Th1, Th2, Th17,…). Par une série d’approches moléculaires et cellulaires (profils épigénétiques, facteurs de transcription, modèles d’interaction T/APC in vitro et in vivo), nous tenterons de comprendre comment ces cellules, issues d’un même précurseur hématopoïétique, acquièrent en périphérie, et en absence d’antigène, la capacité de produire des profils cytokiniques distincts. Le mode d’action des adjuvants fera aussi l’objet d’une série d’études. Cette partie du projet devrait mettre en évidence de nouveaux mécanismes de contrôle de la réponse adaptative par les APC de la réponse innée, mécanismes qui seraient impliqués dans de nombreuses conditions physiologiques et pathologiques.
WP5. Nouvelles stratégies d’immunothérapie des cancers.
L’objectif de ce WP sera d’évaluer une série d’approches thérapeutiques visant à mieux exploiter le système immunitaire dans la lutte contre les cancers. Ces nouvelles thérapies seront dans un premier temps évaluées dans le cadre de modèles tumoraux précliniques (modèles animaux) du mélanome et du cancer du poumon. Les approches thérapeutiques innovantes se baseront sur l’étude des molécules impliquées dans la présentation des antigènes tumoraux, et sur les propriétés vaccinales des ARNm, une nouvelle méthode permettant l’expression et le ciblage in vivo d’antigènes tumoraux. Enfin, la possibilité d’activer les lymphocytes T « de type inné » exprimant des récepteurs sera examinée. La capacité de ces cellules à se positionner naturellement dans les tissus périphériques (comme la peau), l’expression par défaut de médiateurs cytotoxiques (granzymes) et inflammatoires (IFN), et enfin leur capacité de reconnaissance de cibles antigéniques non polymorphes (indépendantes du locus MHC) en font des effecteurs de choix dans le cadre des réponses anti-tumorales. Nous avons récemment identifié une population de lymphocytes T chez l’homme capable de reconnaitre de nombreuses lignées tumorales. Enfin, la possibilité d’exploiter les propriétés anti-tumorales d’une sous-population de cellules T résidant dans la peau sera évaluée dans un modèle de mélanome murin.
L’objectif global de notre projet de recherche vise à identifier de nouvelles stratégies d’immunothérapie permettant d’orienter la différenciation des lymphocytes T (en fonction du résultat clinique désiré (induire ou supprimer une réponse immune), tout en minimisant les effets secondaires (dommages aux tissus sains) de ces interventions thérapeutiques.