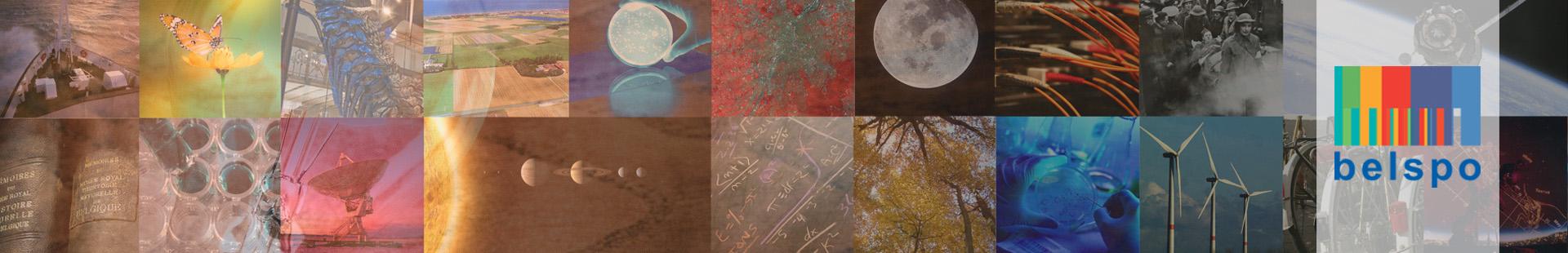
Projet de recherche P7/40 (Action de recherche P7)
Introduction
Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) représentent la plus grande famille de récepteurs membranaires. Ces récepteurs et leurs ligands structurellement très divers jouent un rôle majeur dans tous les aspects de la physiologie et de la physiopathologie, et constituent des cibles pour environ la moitié des composés actifs actuellement utilisés comme agents thérapeutiques. Alors que les RCPGs ont longtemps été considérés comme des monomères, il est actuellement admis qu’ils forment des homo-et/ou hétéro-complexes et qu’ils sont ancrés dans les régions de la membrane comportant des composants lipidiques/(glyco)protéiques spécifiques. Ces facteurs contextuels modulent la signalisation et peuvent provoquer des dérégulations de récepteurs, ce qui est à l’origine de certaines maladies. Les partenaires du présent programme ont joué un rôle majeur dans la caractérisation de nombreux récepteurs couplés aux protéines G et leurs ligands chez la levure, les insectes et les mammifères. Le domaine des GPCRs est maintenant entré dans une phase passionnante de son évolution. En effet, les données structurelles deviennent disponibles à un rythme rapidement croissant, et cela affectera profondément tous les autres aspects du domaine. Sur la base de l'expérience antérieure du réseau, et grâce à de nouveaux partenaires et des collaborations externes dans le monde entier, nous avons l'intention de rester à la pointe de la recherche sur les GPCRs, en effectuant des études de haut niveau dans les directions nouvelles prises par le domaine. Avec un nouvel accent sur les aspects structurels, nous étudierons plus avant des aspects généraux et spécifiques des RCPGs, avec comme but ultime, l'amélioration de la santé humaine et de la qualité de vie.
Etude structurelle des changements conformationnels des RCPGs
Nous déterminerons la structure cristallographique de RCPGs spécifiques dans leurs différentes conformations fonctionnelles. Pour ce faire, nous générerons des anticorps recombinants monoclonaux simple chaîne à partir de camélidés (nanobodies), capable de stabiliser des conformations spécifiques des récepteurs (conformation inactive, conformation active(s), complexes avec les protéines G, -arrestines ou autres partenaires). Ces nanobodies seront utilisés comme une aide à la purification des récepteurs correctement reployés et à la cristallisation de ces récepteurs. Les structures seront déterminées par cristallographie aux rayons X, en collaboration avec plusieurs groupes étrangers (Brian Kobilka, Stanford, USA; Gebhard Schertler, Institut Paul Scherrer, Suisse). Les structures cristallines seront utilisées pour modéliser l'organisation structurale d'autres RCPGs d'intérêt et de leur interaction avec des ligands et des protéines de signalisation (agonistes et antagonistes, modulateurs allostériques, protéines G, kinases, -arrestines), visant à mieux comprendre les mécanismes d'activation des RCPGs en général. Nous poursuivrons également l'analyse des conséquences fonctionnelles de l’oligomérisation des RCPGs in vitro et dans des modèles animaux, avec l'aide des informations structurelles obtenues.
Voies de signalisation des RCPGs
Des récepteurs humains, d'insectes et de levure seront étudiés pour leurs propriétés de signalisation, avec un accent particulier sur les concepts récents tels que les voies de signalisation indépendantes des protéines G, l’agonisme biaisé, la régulation allostérique des récepteurs au sein d’oligomères et la régulation croisée avec d'autres systèmes senseurs et voies de signalisation. Nous analyserons les modifications de la signalisation selon les ligands utilisés, l'interaction du récepteur avec d'autres partenaires (parmi lesquels d'autres RCPGs, GRKs, -arrestines), et de l'environnement du récepteur (composition lipidique de la membrane). Des techniques de transfert d'énergie seront utilisées pour étudier l'interaction directe de récepteurs spécifiques avec les sous-unités des protéines G et les autres partenaires de signalisation, ainsi que l'activation de ces protéines. Des analyses comparatives de signalisation seront faites entre les mammifères, les insectes et les cellules de levure sur la base d’analogies structurales et fonctionnelles. En outre, de nouvelles voies de signalisation et/ou régulations seront explorées, et recherchés dans les autres espèces lorsqu'elles ont été découvertes dans une espèce, afin d'évaluer leur caractère universel.
Identification de nouveaux récepteurs et leurs ligands.
Il existe encore beaucoup de récepteurs orphelins, dont les ligands et les fonctions ne sont pas connus, dans les génomes de mammifères et d'insectes. Nous nous concentrerons sur la caractérisation de ces récepteurs, par l'identification de leurs ligands, et la détermination ultérieure de leurs fonctions. Plusieurs de ces programmes ont été initiés au cours de la phase précédente (identification de ligands ou purification en cours d’activités biologiques), et ces programmes seront poursuivis au cours de cette phase VII. Nous étudierons des récepteurs humains d’agents chimiotactiques pour les leucocytes (par exemple des chimiokines avec ou sans modifications post-traductionnelles), de neuropeptides, d’hormones glycoprotéiques et du glucose, des récepteurs d’insectes pour des neuropeptides et d’hormones peptidiques/protéiques et des récepteurs senseurs de nutriments chez la levure. La phylogénie et des éléments évolutifs seront utilisés dans cette approche.
Caractérisation fonctionnelle de récepteurs spécifiques dans les processus physiologiques et les maladies
Constituant une famille essentielle de récepteurs de médiateurs extracellulaires, les RCPGs régulent de nombreux processus biologiques. Certains récepteurs spécifiques, parmi lesquelles plusieurs récepteurs identifiés par les partenaires du réseau au cours des années précédentes, seront étudiés en détail afin de déterminer leur rôle dans les processus physiologiques, et leur implication dans les maladies humaines. Nous allons examiner quatre domaines d'une importance cruciale pour de futures applications thérapeutiques, à savoir le métabolisme, l'immunité, le cancer et les troubles du système nerveux. Pour chacun de ces domaines, dans lequel notre consortium possède une expertise de longue date, cette approche impliquera des études in vitro, ainsi que dans des modèles de maladies in vivo et des organismes génétiquement modifiés, en combinaison avec des approches post-génomiques et phénomiques avancées. Nous étudierons, parmi d’autres systèmes, des récepteurs hormonaux d'insectes et de mammifères dans le développement, des récepteurs d’agents chimioattractants et de nucléotides dans l'immunité et le cancer chez les mammifères, des récepteurs de neuropeptides chez les mammifères et les insectes, et des RCPGs senseurs de nutriments chez la levure et les mammifères. Plusieurs partenaires contribueront de concert à chacun de ces domaines. Les données physio(patho)logiques résultantes seront complémentées par des informations obtenues à partir des autres parties du programme.
Le réseau
La composition de notre consortium assure la continuité des activités les plus prometteuses et des interactions initiées lors de la phase précédente du programme, et permet l'incorporation de nouveaux thèmes de recherche dans des domaines émergents de la recherche sur les RCPGs. Dans ce réseau modifié, nous avons intégré un nouveau partenaire belge (P4, Jan Steyaert, VUB), qui a joué un rôle clé dans les percées récentes dans le domaine émergent de l'analyse structurelle des GPCRs. En effet, l'utilisation de nanobodies générés par ce groupe a contribué à la détermination de la structure cristalline tout d'abord du récepteur 2-adrénergique dans sa conformation active, et ensuite de la structure de ce récepteur en complexe avec sa protéine G. Nous espérons que ces récents développements conduiront à une explosion de la recherche structurale dans le domaine des RCPGs au cours des années à venir, et que notre réseau belge continuera à jouer un rôle essentiel dans cette voie passionnante. Nous avons également intégré un nouveau partenaire étranger (INT1, Silvano Sozzani, Brescia, Italie), qui est déjà très étroitement connecté à deux des partenaires belges (P1 et P3) dans les domaines de l'immunité et du cancer. Au cours des dernières années, s’est aussi produite une convergence attendue depuis longtemps entre les voies de signalisation activées par les RCPGs dans la levure et chez les organismes multicellulaires comme les insectes ou les mammifères. Outre les échanges conceptuels et technologiques qui ont été faits entre P2 et les autres partenaires au cours de la phase précédente, il existe maintenant l’opportunité d’une intégration plus complète des objectifs des partenaires travaillant sur les RCPGs de mammifères, d’insectes et de levure, dans le cadre de la structure, des cascades de signalisation des RCPGs et de leur rôle dans le métabolisme des cellules et des organismes. Le réseau aura donc l’occasion de renforcer sa cohésion autour d'un certain nombre d'objectifs principaux, et favorisera cette cohésion par l'organisation de congrès et d'ateliers internationaux, d’écoles d'été dédicacées aux RCPGs, et la continuation des programmes d'échange d'étudiants.