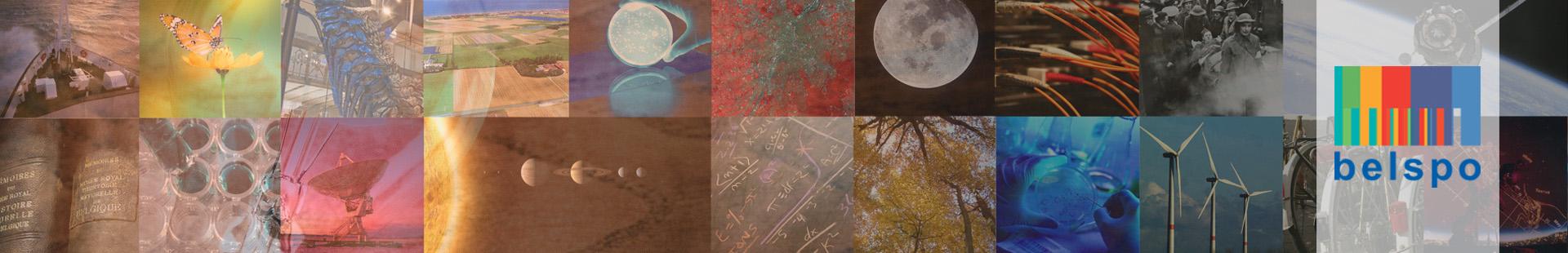
Projet de recherche P7/44 (Action de recherche P7)
Les protéines sont les produits principaux de l’information génétique et les macromolécules biologiques clés déterminant la structure et la fonction de tous les systèmes cellulaires vivants. Les protéines dirigent le développement des organismes, le métabolisme et les réponses aux stimuli environnementaux. Elles interagissent avec des ligands de taille différente qui peuvent être substrats, inhibiteurs, effecteurs, acides nucléiques, bicouches lipidiques ou protéines. Des altérations non désirées de ces interactions peuvent transformer un processus cellulaire de normal à aberrant, résultant en un grand nombre de pathologies. Parallèlement, le développement de petites molécules pouvant interférer avec les fonctions cruciales des protéines dans les cellules vivantes, occupe une place importante en thérapie humaine et en chimiothérapie antimicrobienne basée sur la perturbation des processus métaboliques.
Dans cette ère post-génomique, nous avons accès à une grande quantité d’informations sur les génomes d’un nombre croissant d’organismes. Par contre, nous sommes encore loin de pouvoir intégrer toutes ces données pour comprendre le fonctionnement des cellules vivantes. Ce paradoxe s’explique par le fait que la détermination des séquences génomiques a progressé beaucoup plus vite que notre connaissance des relations structure-fonction et des interactions entre biomolécules. Traditionnellement, les protéines ont été étudiées comme entités isolées. Cependant, dans l’ère post-génomique, un nouveau type de recherche a vu le jour visant à saisir une vue intégrative des fonctions des protéines dans le contexte des organismes vivants. La science moderne des protéines s’intéresse dès lors à tous les niveaux d’organisation de la vie, de la protéine isolée au système complexe impliquant des interactions entre protéines, ligands, acides nucléiques et allant jusqu’à l’étude des réseaux dynamiques dans les cellules et les organismes modèles. Pour ces raisons, un projet intégré sur la science des protéines est un défi dans un domaine de recherche hautement interdisciplinaire allant de la biophysique à la chimie et à la biologie cellulaire.
The but du projet iPROS est de promouvoir une approche intégrée de la science des protéines pour améliorer notre compréhension des structures et fonctions des protéines. Il est également de former de jeunes chercheurs à conduire et développer une recherche de très haut niveau dans ce domaine. Au niveau fondamental, quatre lignes de recherche seront suivies : (i) le repliement des protéines, (ii) l’ingénierie des protéines et les interactions protéine-ligand, (iii) les protéines cibles contre la résistance bactérienne, (iv) les assemblages protéiques supramoléculaires et le métabolisme cellulaire. Chacune de ces thématiques constitue un work package. Pour développer ces quatre axes de recherche de la manière la plus efficace, des collaborations ont été établies entre les équipes belges de premier plan dans la science des protéines et des disciplines complémentaires. Ces groupes partageront les technologies disponibles en biologie moléculaire, structurale et cellulaire, en bactériologie, en biophysique, en bioinformatique, en chimie des protéines et des membranes, en enzymologie, et en chimie médicinale et chimie théorique. La contribution des partenaires étrangers est particulièrement précieuse en biophysique, en biologie structurale, en métabolisme de la paroi cellulaire bactérienne et en régulation et développement cellulaire procaryotique. Les partenaires du PAI utilisent des approches différentes et complémentaires. C’est pourquoi ce réseau créera une fertilisation croisée bénéfique pour chaque partenaire et sera un instrument unique en Belgique dans le domaine des protéines. En vitesse de croisière, les étudiants et les groupes de recherche belges bénéficieront d’une expertise unique dans ce domaine des interactions et du repliement des protéines.
Description des work packages
Work package 1 : Repliement des protéines (Partners: P1, P3, P6 and INT1)
Comprendre les aspects fondamentaux du repliement des protéines est crucial pour décrire les processus biologiques, que ce soit la transcription, les moteurs moléculaires ou les maladies associées à leur mauvais repliement. Les études classiques in vitro des protéines modèles, incluant les enzymes des extrémophiles, seront poursuivies en utilisant les techniques de mélanges rapides en conjonction avec les techniques de spectroscopie optique et RMN, pour obtenir une vue complète du processus de repliement. En utilisant plusieurs protéines modèles, nous étudierons les mécanismes liés au mauvais repliement des protéines et à la formation des fibres amyloïdes apparaissant dans diverses amyloïdoses neurodégénératives et systémiques. Des souches transgéniques de Caenorhabditis elegans exprimant des protéines sélectionnées seront créées pour étudier la formation des fibres et la toxicité in vivo. Nous analyserons également comment les organismes vivants prennent avantage de l’habilité inhérente des protéines à former ces structures. Un exemple particulièrement bien documenté d’une amyloïde fonctionnelle est la curline dont les fibres sont utilisées par E.coli et Salmonella pour former des biofilms et coloniser des surfaces non biologiques. Nous explorerons comment les sous-unités amyloïdogéniques sont transportées et assemblées à la membrane externe sans effet cytotoxique. Nous étudierons aussi le repliement oxidatif dans le périplasme de Caulobacter crescentus, modèle favori pour l’étude de la régulation du cycle et la différentiation cellulaire.
Work package 2 : Ingéniérie des protéines et interactions protéine-ligand (Partners: P1, P2, P3, P4)
Le WP2 combinera des approches biologiques, structurales, chimiques et combinatoires pour explorer les fonctions et interactions protéiques. The premier but du WP2 est d’améliorer des protéines ou enzymes pour créer de nouvelles propriétés telles que l’affinité pour un ligand, des effets durables et/ou une meilleure sélectivité. De plus, nous développerons et caractériserons des protéines hybrides capables d’interagir avec différents polysaccharides ou de présenter une régulation allostérique. Le deuxième champ du WP2 sera dédié aux interactions protéine-ligand telles que protéine-ion métallique ou protéine-lipide. Nous nous focaliserons sur les ATPases de type P transporteuses de zinc/cadmium d’Arabidopsis halleri. Par comparaison à leurs homoloques procaryotiques, beaucoup de transporteurs de métaux de plantes ont acquis des domaines cytoplasmiques supplémentaires qui pourraient être impliqués dans la liaison aux métaux, à la détection des métaux et/ou à la régulation de l’activité protéique. Nous proposons d’évaluer leur affinité à lier les métaux et leurs changement structuraux liés à cette liaison. De plus, le mécanisme de transduction du signal initié par la présence de la pénicilline dans le milieu sera analysé en déchiffrant les interactions entre les lipides et le domaine transmembranaire de BlaR.
Work package 3 : Protéines cibles contre la résistance bactérienne (Partners: P1, P2, P3, P5, P6 and INT2)
WP3 vise à étudier les protéines identifiées comme cibles pour combattre la résistance bactérienne et développer des stratégies chimiques et des approches de découverte de composés guides. Le premier sujet principal traite des protéines impliquées dans la biosynthèse du peptidoglycane (PG). Les phosphatases C55-PP catalysent la déphosphorylation du C55-PP créant la forme active du porteur lipidique requise pour la translocation des unités de glycane à travers la membrane cytoplasmique. La polymérisation de la macromolécule de PG est effectuée par des protéines liant la pénicilline (PLP) de classe A via leur activité transglycosylase (TGase) et transpeptidase (TPase). Un problème majeur de résistance bactérienne concerne la résistance aux antibiotiques à noyaux -lactame à travers l’émergence de cibles modifiées (PLP résistantes, rPLPs) et la synthèse d’enzymes détruisant les -lactames (-lactamases). Dans le cadre du PAI P6/19, un travail considérable a été réalisé sur la synthèse d’antibiotiques dirigés contre les TGases, les rPLPs et les-lactamases avec plusieurs composés guides dans le pipeline. De plus, des approches nouvelles seront envisagées incluant la synthèse de nouveaux squelettes chimiques, le dépistage des librairies de peptides et de fragments via la cristallographie aux rayons X.
Work package 4 : Assemblage protéique supramoléculaire et métabolisme cellulaire ((Partners : P1, P2, P4, P6, INT2 and INT3)
Les protéines n’agissent pas comme entités isolées. Dans un contexte cellulaire, elles sont influencées par des interactions permanentes et transitoires avec d’autres biomolécules. De plus, leur expression et leur activité sont fortement régulées par des connections au sein de réseaux protéiques. Le WP4 se consacre à mieux comprendre l’assemblage et le mode d’action de la machinerie protéique et des réseaux de signaux qui déterminent l’état de la cellule. Les sujets principaux du WP4 sont : (1) l’analyse des interactions et des changements structuraux des principales protéines membranaires du divisome de E.coli pour avoir une image dynamique de ce complexe multiprotéique et déterminer les interactions essentielles pour la division cellulaire, (2) la compréhension des évènements de signalisation et des mécanismes moléculaires résultant de l’adaptation des organismes au stress environnemental conduisant à la résistance, l’adaptation ou les transitions vers différents états cellulaires (biofilms, sporulation, production d’antibiotiques).
Work package 5 : Réseau et dissémination (Tous les partenaires)
Le coordinateur sera responsable de l’organisation générale du réseau. Pour l’aider, un comité de pilotage scientifique sera mis sur pied, constitué des responsables des WP et d’un chercheur senior de chaque partenaire. Le comité de pilotage tiendra des réunions régulières. Les responsables de WP coordonneront leur propre WP et seront responsables du travail effectué. Un sous-comité assurera la dissémination des résultats par un site web, des newsletters, des séminaires et des réunions internationales.
Work package 6 : Formation (Tous les partenaires)
Une attention particulière sera donnée à la formation des étudiants en doctorat et aux jeunes chercheurs. Un programme de formation sera organisé pour améliorer leurs perspectives de carrière en élargissant leurs compétences scientifiques. Les chercheurs confirmés bénéficieront également d’un support pour améliorer les connaissances et /ou acquérir de nouvelles compétences. En plus des conférences déjà dispensées dans les différentes hautes écoles, le consortium du PAI organisera des activités spécifiques sous la forme d’ateliers, de semaines thématiques et de séminaires.