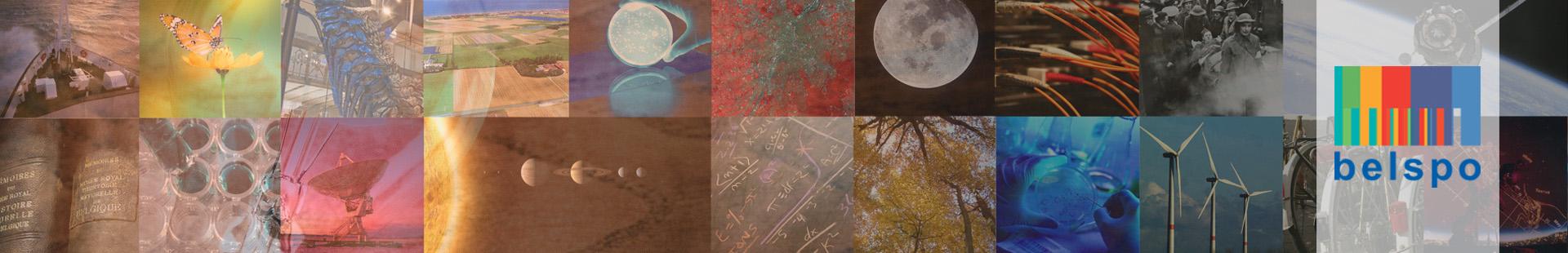
Projet de recherche TA/00/16 (Action de recherche TA)
Ce projet étudie l’importance de l’aide internationale pour la reconstruction des services publics en République Démocratique du Congo.
Vers la fin des années ‘90, les acteurs principaux de ladite Communauté Internationale ont formulé le « Nouveau Paradigme d’Aide ». Bien que le débat entre ces différents acteurs ne soit pas encore clos, on est arrivé à un consensus international fondé sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui devraient être atteint en 2015, et sur un dialogue politique orienté vers les principales faiblesses institutionnelles : on a mis l’accent sur la réintégration des structures de gouvernement national afin d’augmenter la « propriété » de l’aide au développement internationale. En RDC, ce nouveau paradigme est déjà mis en œuvre pour des raisons plutôt politico-militaires. Après les élections présidentielles et générales récentes, la Communauté Internationale a fait de la reconstruction post conflit un objectif stratégique important dans la stabilisation de toute la région de l’Afrique Centrale. L’accord de paix de Sun City (2002) a marqué le début d’un flot financier grandissant vers le pays afin d’appuyer le processus de démocratisation politique, de démobilisation militaire et de reconstruction socio-économique.
Ce projet de recherche vise surtout à étudier la façon par laquelle cette situation nouvelle se reflète dans la réalité quotidienne. Au cours de cette dernière décennie, l’état congolais a cessé de fonctionner comme prestataire de certains services publics de base et dès lors, les gens ont créé certains arrangements avec, autour ou contre les institutions locales des services publics. Par hypothèse, ces arrangements sont propres aux différentes situations locales et reflètent les configurations de pouvoir sur place entre les acteurs étatiques locaux, les acteurs de la société civile et les autres initiatives de la population locale. On devrait donc considérer la situation actuelle comme une phase nouvelle du processus encore inachevé, fragile et réversible de la formation de l’état en Afrique. Par conséquent, la capacité des représentants locaux de l’état dépend largement du degré dans lequel ils « rentrent » dans les constellations locales de pouvoir. Donc, pendant que selon le « Nouveau Paradigme d’Aide » des donateurs visent à négocier (de nouveau) avec des acteurs étatiques et des organisations privées et non-gouvernementales, une réalité différente est masquée au niveau interne : à savoir la position extrêmement fragile de ces acteurs de développement vis-à-vis des groupements d’intérêts locaux – eux-mêmes nés partiellement comme réponse à la situation de crise continuelle. La façon dans laquelle le flux d’aide est absorbé et se traduit en services publics responsables dépendra donc largement des configurations existantes de pouvoir local et/ou de la manière dans laquelle ces configurations sont renégociées.
Dès lors, une question importante est de savoir s’il sera effectivement possible d’ « acheter » du développement durable avec l’argent des donateurs dans le cas du Congo. Des expériences précédentes montrent qu’il n’existe aucune réponse explicite à cette question : le rôle joué par la communauté internationale vis-à-vis des états en crise ou sortant d’une situation de guerre dépend largement de la façon dans laquelle les organisations de développement répondent à la configuration institutionnelle locale. Il n’existe pas de solution miracle à ce problème. Néanmoins, on pourrait dire que l’appropriation locale des initiatives de développement est un déterminant crucial du succès.
Au cours de cette recherche, l’équipe étudiera de quelle façon la reprise récente de l’aide destinée au Congo et à l’état de la RDC est « traduite » en pratiques institutionnelles changeantes. Bien que la recherche s’appuiera sur d’autres expériences africaines récentes de l’industrie de l’aide, en intégrant le cas du Congo à la littérature plus large de ce sujet, elle se limitera à la RDC elle-même. La pertinence du Congo-Kinshasa comme étude de cas est montrée par l’importance du processus de paix et de démocratisation pour ce pays même, pour l’Afrique Centrale en général et pour le rôle de la Belgique dans cette évolution.
Ce projet propose d’étudier ces questions via une analyse comparative d’études de cas. Celle-ci nous permettra à comparer des zones à des distances différentes du centre politique (des communautés urbaines et périurbaines de Kinshasa et du capital économique d’autrefois Lubumbashi). L’équipe de recherche consiste en spécialistes d’universités belges et congolaises, du Musée Royal de l’Afrique Centrale (Belgique) et de LASDEL (un centre de recherche scientifique à Niamey en contact avec des réseaux de recherche euro-africains socio-anthropologiques). L’implication des chercheurs de LASDEL, avec des expériences reconnues internationalement en ce qui concerne l’étude des services publics en Afrique de l’Ouest dans un contexte de décentralisation, garantit un fort appui méthodologique et l’intégration de ces études de cas à la totalité des recherches africaines comparables. Dans l’analyse d’études de cas présentée, l’accent est mis plus spécifiquement sur les secteurs de l’éducation et de la gouvernance environnementale, avec au moins deux sites de recherche par secteur. De plus, une importante valeur ajoutée sera la combinaison des données quantitatives et qualitatives. Celle-ci est par ailleurs aussi stimulée à cause de la composition de l’équipe de recherche (des économistes, des sociologues et des anthropologues).
L’objectif principal de ce projet est de fournir un appui aux donateurs bilatéraux et multilatéraux et aux autres décideurs politiques dans la conceptualisation des programmes d’aide efficaces dans les domaines de la gouvernance environnementale et de l’éducation, notamment dans les zones périurbaines de quelques grandes villes en RDC.
Dans le cadre de cet objectif principal, on vise à comprendre les arrangements institutionnels dans les deux secteurs, à travers la (ré)analyse de la littérature secondaire, des banques de données existantes et de la recherche qualitative nouvelle.
De plus, l’équipe analysera les façons par lesquelles les agences des donateurs d’une part et l’administration étatique d’autre part interagissent avec la société civile et d’autres acteurs au niveau local dans les domaines précisées.
Cette recherche est basée sur quelques points de départ. Comme première hypothèse, il est postulé que l’état congolais est extrêmement fragmenté. Dès lors, les détenteurs du pouvoir locaux jouissent d’une autonomie assez large, même dans les zones périurbaines du capital et d’autres grandes villes. Bien que cette hypothèse soit largement descriptive, elle pourrait critiquer le « nationalisme méthodologique » adhéré par la majorité de la littérature sur l’aide au développement. De plus, cette hypothèse prend en compte le degré de « fragilité » de l’état congolais.
Un deuxième supposé est que le caractère fragmenté du pays n’a aucunement provoqué la faillite automatique des services publics, mais que des solutions locales peuvent ou ne peuvent pas résoudre certains problèmes de service public. Une comparaison entre les deux secteurs (l’éducation de base et la gouvernance environnementale locale) nous permettra à comprendre le rôle joué par ces arrangements institutionnels et par les détenteurs du pouvoir locaux.
Troisièmement, on postule que les détenteurs du pouvoir locaux ont la possibilité de se protéger d’influences externes et donc d’élargir leur marge de manœuvre vis-à-vis ces acteurs. Ceci est un élément crucial dans la résolution des problèmes de service public, puisqu’il ne peut ou ne peut pas contribuer à une responsabilité (« accountability ») accrue par rapport aux différents utilisateurs des services publics.
La dernière hypothèse suppose que le rôle des acteurs internationaux dépend de la façon dans laquelle ils peuvent s’aligner aux intérêts locaux.
Quelle Reconstruction? Acteurs et enjeux de la reconstruction post-conflit en RDC : rapport final
Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2231)
[Pour télécharger]