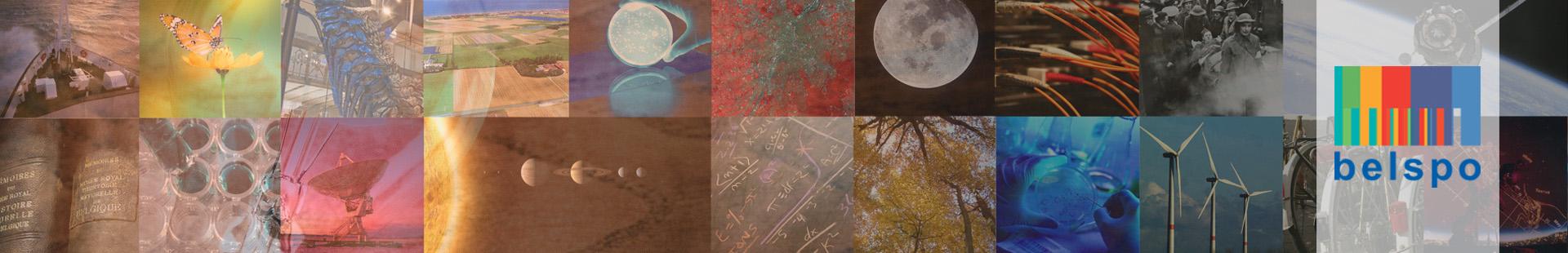
Projet de recherche P5/16 (Action de recherche P5)
Si personne ne conteste que les sciences et technologies ont un impact général et décisif sur nos vies, nos sociétés et nos environnements, il est par contre surprenant de voir persister la thèse du partage selon laquelle la science se borne à établir des "faits" à partir desquels la délibération politique a pour responsabilité de déterminer des "valeurs". Cette thèse ne permet finalement pas de rendre compte des multiples enchevêtrements dynamiques entre science ("nature") et société ("culture") qui ont été portés à la lumière du jour tant par l'expérience concrète et pratique des sciences et les travaux de certains penseurs de la science (comme p.ex. Foucault, Serres, Stengers et Latour) que par des mouvements de contestation sociale (en matière p.ex. de biogénétique, d'environnement, de 'cloning', etc.).
Nous posons, en tant que "fait nouveau", la nécessité de penser l'impact des sciences en référence à l'"Etat de droit démocratique". De fait, des notions-principes comme la médiation juridique des droits et d'intérêts, la participation démocratique, la rule of law, la transparence, l'accountability, l'intérêt public, les droits de l'homme et la liberté individuelle s'inscrivent désormais parmi les contraintes du travail scientifique. Mais il s'agit d'en explorer les conséquences en ce qui concerne l'activité scientifique et la formation universitaire, car la pertinence de ces notions-principes a pour condition un intérêt et une ouverture actifs des scientifiques pour les activités et savoirs déployés par leur collègues d'autres disciplines et, qui plus est, par leurs concitoyens : il s'agit de la production de savoirs "intéressants", au sens étymologique où interesse signifie créer des liens, produire des possibilités de mise en rapport. Autrement dit, la question de l'impact des sciences fait spontanément émerger la question du caractère public/d'intérêt général de la recherche scientifique, car s'il y a lieu de relier les sciences et l'Etat de droit démocratique, il faut se demander d'une part quelle place pourrait occuper l'intérêt public/général dans la conduite de la recherche scientifique et de l'autre mettre au centre la question de savoir en quoi (en rapport à quels enjeux?) et comment (par quelle procédure?) une recherche peut être et devenir publique.
La présente recherche a donc pour objectif général de concevoir l'activité scientifique et technique dans un Etat de droit démocratique. Théoriquement, il s'agit de repenser les rapports entre sciences et société par le biais de l'étude inter- ou transdisciplinaire de deux cas de figure actuels (l'homme corrélé et la biotechnologie et la question de la sécurité alimentaire). Juridiquement, il s'agit ainsi de poser et définir l'exigence et les limites de la médiation juridique par rapport aux activités scientifiques et techniques. D'un point de vue politique et constitutionnel il faudra, par rapport à ces mêmes activités, concevoir des nouvelles formes de représentation, de mise en balance de pouvoirs et de tansparance. A partir de l'éthique il faudra faire le point sur les nombreuses frictions entre pratiques scientifiques et questions éthiques. D'un point de vue plus concret ou opérationnel nous voulons aboutir à la proposition d'outils procéduraux de nature juridique, éthique et autres pouvant contribuer à la mise en oeuvre des résultats théoriques et conceptuels de cette recherche.
La principale originalité de ce projet est néanmoins éducationnelle et concerne la formation des chercheurs: notre recherche est conçue comme une recherche-action ou comme une 'expérience' à mener en interaction avec des chercheurs d'horizons différents au delà de l'exclusion mutuelle (pour cause d'ignorance). La question de savoir comment développer un appétit/intérêt commun partant de différentes façons de voir les choses ne peut trouver de solution que sur le terrain. Ainsi, par la voie de l'expérience, notre projet tentera de d'identifier les nouvelles urgences de formation auxquelles devraient répondre des pratiques de savoir reliées à l'Etat de droit démocratique (école doctorale). Il s'agit donc, outre l'ambition plus classique de "production de savoirs" tels que définis par les différents "workpackages", d'une tentative de "production de mise en communication" des savoirs, et ceci au sens fort : les savoirs ici ne sont pas considérés du point de vue d'un contenu que chacun pourrait s'approprier mais du point de vue où ils doivent "compter", "importer", faire partie de la manière dont un chercheur pose ses questions. C'est pour souligner ce défi que notre projet parle de "loyauté", ou de "lien", ou d'"attachement".